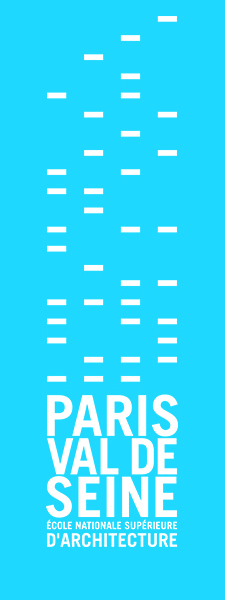SUJETS TRAITÉS A L'OCCASION DU CYCLE SUR LE COMMUN, ET SUR ALTERNATIVES / INNOVATION :
MEMOIRES à soutenir en 2024
La controverse du Régionalisme critique : quelle brique toulousaine ? _ Sandrine Gérard
S’occuper du patrimoine urbain, occuper un patrimoine commun _ Théa Lartisien
Établissement des pédagogies : de l’innovation à l’école primaire _ Julie Lévêque
Terres d’architectes _ Quand les matériaux éco-sourcés modifient les missions de l’architecte _ Maud Thirouin
+...
MEMOIRES soutenus en 2023
L’architecte en campagne. Alternatives pour une Moe du commun rural _ Oussama Allaoua (MR en cours)
Adaptation en cours. L’école primaire, un lieu stratégique ? _ Justine Brausch
Langages de l’architecte _ Maily Briche (MR)
La place aux merveilles. Jamaa El-Fna, entre souvenir, fiction et projection _ Soukaina Elamrani
Produire la ville, en ville. Construire une autonomie alimentaire en Ile-de-France _ Hiba Elyoubi (MR en cours)
Entre ville et port. Marseille, rue de la République _ Justine Griffart
La revendication du corps. L’écho du Krump dans l’espace public parisien _ Affoué-Lucia Inza
Nouveaux récits : les architectes face à la « crise du temps » _ Jean-Cassien Marmey
Le care par le faire. Le cas d’un centre d’hébergement d’urgence à St Maur des Fossés _ Thomas Nodari (MR)
Comment « faire » ? La formation, outil de transformation de l’acte de conception _ Stella Placet (MR)
MEMOIRES soutenus en 2022
Appropriation. Modeler l’espace à son usage, à Nantes ou Val de Seine _ Baptiste Cabrol
Spéculations sur l’immobilier : SCI APP, un modèle pour transmettre le patrimoine du logement ? _ Luke Gates (MR)
Tiers-lieu, histoire d’un malentendu. Dire la quête d’utopie par le flou d’une notion _ Manon Goudard
La dystopie, une cosmogonie paradoxale. Ou, ce qui est à l’œuvre chez Damasio _ Anatole Kuijper
Entre art et architecture, conception et perception, la question du détail _ Cécilia Lopez
Garage Dream. Vu au cinéma : le suburbain états-unien, creuset de l’imaginaire _ Maria-Monica Martinez
Architecture et improvisation. Une réflexion en trois appuis théoriques _ Po Shen Ou (MR)
Noteboom, ou le paysan architecte. Enjeux de la transition écologique des espaces agricoles _ Tanguy Pruvost (MR)
La terre est de retour. Une mutation pour l’architecture camerounaise _ Myriam Tounir
MEMOIRES soutenus en 2021
Hospitalité ou hostilité ? La place des réfugiés à Paris-la Chapelle – Inès de Bufala
Réversibilité. Désir et nécessité architecturale au regard du droit – Thiphaine de Sancy
La face cachée de la conception. Modes de représentation en architecture à l’Oma, chez Kuma – Théo Diverrès
Sauvages mais urbains. Quand les animaux s’invitent en ville – Philippine Marie
Aux limites de la folie. Ouverture de l’espace de soin, comme instrument de la guérison – Lola Negri
Good-bye Youri. Aléas du commun en banlieue rouge – Ionela Ngonga
Hors-Norme. Du sensoriel au sensible, dans l’architecture de l’autisme – Dylan Pereira
La fabrique de la ville. Belle de mai, une gentrification marseillaise – Julie Perez
De la permanence architecturale… – Anne-Sophie Perny
En Rue / Anru. En communs de la rénovation urbaine. Léa Villain (MR)
MEMOIRES soutenus en 2020
De l’occupation temporaire à l’urbanisme transitoire. Ce qui dure dans le temporaire - les Grands voisins (Paris) – Arthur Clément
Graines de ruines (Athènes, lieux de culture alternatifs nés de la crise) – Laure Ayats Andres
Société apprenante et communs de la connaissance. D’une sérendipidité architecturale – Louise Michaud (MR)
Résistance d’un bocage [en] commun. Notre-Dame-des-Landes, un territoire en lutte autour d’un paysage en devenir – Pauline Rocher
Fête, ville et commun. Cas particulier de la Techno-parade à Paris – Victoria Masson
Méthode, langage, communication, temporalité du projet urbain contemporain (d’un Référentiel pour la conception des places du Grand Paris Express) – Charlotte Villiot
MEMOIRES soutenus en 2019
La bataille de la terre – une expérience du commun à Notre Dame des Landes - Elissa Al Saad
L'intelligence éco-artificielle : informer le réemploi des matériaux de construction - Laurie-Jade Guérin
L’espace public affranchi au fil des activités ludo-sportives - Antoine Imbert
Vieux en ville - de l'accessibilité et de l'inclusivité en architecture - Madeleine Niepceron
Interfaces et interrelations - expérience multisensorielle de l'art contemporain au Palais de Tokyo - Alix Beau-Brechignac
Les jeux des « communs nichés », à la Cité internationale universitaire de Paris - Ghita Cherradi
La bataille de Reeperbahn – d’une réappropriation de l’expérience urbaine, à Hambourg - Félix Korganow
Vivre ensemble en Antarctique - d’un commun paradoxal - Angelo Trinca
MEMOIRES soutenus en 2018
Le commun croisé des « chez moi étendus » dans l’expérience tokyoïte – Mathilde Redouté (MR)
Public/privé/commun : expériences du marketing sensoriel dans les gares contemporaines – Julia Jouffroy
Communs et tiers-lieux - Noémie Schweisguth
Open source et partage de la décision - Nathan Meller
Le patrimoine du commun, sur le cas d’un site menacé du littoral – Lisa Dahuron
Affordances et appropriation du mobilier urbain, le sens du commun à Séoul et Paris – Théo Martinelli
L’habitat participatif, une expérience du commun ? – Paul Laperdrix (MR)
La rue comme support d’un commun diffus – Emilie Maumy
La cuisine du squat – Manon Hartmann
Place(s) République(s) – Carolina Menezes (MR)
La bataille de la Maison de l’air – Jeanne Goasguen (MR)
MEMOIRES soutenus en 2017
Saõ Paulo / Paris, le commun de l’infrastructure - Iris Akram
De la richesse de la précarité, génération paradoxale d’un tissu relationnel (Paris-Chapelle) – Laetitia Roggeman
Naples / Paris : friches urbaines, de la place du public dans la ville contemporaine – Baptiste Dusonchet
Fin de la page blanche : réemploi des matériaux et nouvelles conceptions du projet – Caroline Mercier
Espaces du commun (Nuit debout, Untergunther, Université foraine, LabGov) – Léonie Beaujeard (MR)
Ambiances hospitalières, la parole aux soignants – Manon Loup Hadamard
Le marché aux puces, comme figure de l’esthétique relationnelle – Hana Choi
Smart cities : les civic-tech – des nouvelles formes de démocratie par le digital – Nicolas Ayoub (MR)
L’école des préfixes. Ma salle de danse, mes planches, mon terrain de foot… – Laure Djafer
BIBLIOGRAPHIE
ARCHITECTURE / PRAXIS
Atelier Georges et Rollot Mathias, L’hypothèse collaborative, conversations avec les collectifs d’architectes français, Marseille, Hyperville, 2018
Barrault Thibault et Pressacco Cyril: « Inductive research. From practice to research. To practice again. Building site as a catalyst for reflexions », in Practices in Research #03 - Explorations et Cartographies, ULiège, KU Leuven et ULB, 2022
Bruther, Introduction, 2014 ; Bruther et Laurent Stalder, Hyperconfort, Dixit n°1, Les presses du réel, 2020
ChartierDalix, Accueillir le Vivant, L’architecture comme écosystème, ParkBooks., 2019
Collectif Etc, Le Détour de France – Une école buissonnière, Hyperville, 2015
Dorval-Bory Nicolas et Ramillien Guillaume, Visible Invisible, l’invention de nouveaux terroirs par une approche matérielle et énergétique des milieux (catalogue Bap !), Ensa Versailles, 2022
Laurens Christophe (dir.), Notre-Dame-des-Landes ou le métier de vivre, Building Paris et éd. Loco, 2018
Michelin Nicolas : Avis. Propos sur l’architecture, la ville et l’environnement (2006), Alerte – et si on pensait un peu plus à elle ? (2008), Attitudes – propos sur l’architecture, la ville et l’environnement (2010), ed. Archibooks
Parc architectes, L’architecture comme environnement, Park books, 2019
Pca-Stream auto-éditions, dont Stream 04 : « Les paradoxes du vivant », 2017
Mathis Rager, Emmanuel Stern, Raphaël Walther, Le Tour de France des maisons écologiques, Alternatives, 2020
TVK : « Places du Grand Paris, Principes de conception pour les espaces publics du Grand Paris Express ». media-mediatheque.societedugrandparis.fr/pm_1_117_117718-ja409wj20d.pdf _ Cons. 20/04/2021
Vigano Paola, Les territoires de l’urbanisme. Le projet comme producteur de connaissance, Genève, MétisPresses, 2012
ARCHITECTURE RECHERCHE : EN ENSA / EN AGENCE
Bosqué Camille : « La fabrication numérique personnelle, pratiques et discours d’un design diffus. Enquête au cœur des FabLabs, hackerspaces et makerspaces, de 2012 à 2015 », thèse de doctorat, Univ. Rennes 2, 2016
Chiappero Florent : « Du Collectif Etc aux ‘collectifs d'architectes’ : une pratique matricielle du projet pour une implication citoyenne ». Thèse de doctorat en architecture (dir. René Borruey et Stéphane Hanrot), Université Aix-Marseille et Ensa Marseille, 2017
Hallauer Edith : « Du vernaculaire à la déprise d'œuvre : Urbanisme, architecture, design ». Thèse de doctorat en aménagement de l'espace et urbanisme (dir. Thierry Paquot), Paris Est, 2017
Houdart, Sophie et Chihiro Minato, Kuma Kengo, une monographie décalée, Paris, Donner lieu, 2009
Ouvrard Pauline : « Le nouvel esprit de l'urbanisme, entre scènes et coulisses : une ethnographie de la fabrique du territoire de Saint-Nazaire à Nantes », thèse de doctorat, Université de Nantes, 2016 (dir. L. Devisme et E. Pasquier) www.sudoc.fr/203605527
Picon Antoine, La matérialité de l’architecture, Marseille, Parenthèses, 2018
Yaneva Albena, The making of a building: A pragmatist approach to architecture, Peter Lang, 2009
Yaneva Albena, Made by Oma: an ethnography of design, 010 Publishers, 2009
Dossiers de revues
Les cahiers de la recherche architecturale et urbaine, 30/31 : « Trajectoires doctorales 2 », 2014 (dont Chupin Jean-Pierre : « Dans l’univers des thèses, un compas théorique »)
Les cahiers de la recherche architecturale urbaine et paysagère, n°1, 2018 : « Innover ? »
Les cahiers de la recherche architecturale, urbaine et paysagère, 9|10, 2020 : « L’Agence d’architecture (XVIIIe-XXIe siècle). Une entreprise comme les autres ? », dont Mélanie Guenot : « Entre ethos professionnel et logiques d’entreprises : La recherche et l’innovation dans les agences d’architecture »
d’Architectures n°262, « E (V) LAN ! », n°262, mai 2018 : « CIR : qu’est-ce que la recherche en architecture ? »
Culture et Recherche, n°138 : « Architecture. Pratiques Plurielles de la recherche », automne-hiver 2018
amc 299, oct 2021, Margaux Darrieus : « La recherche en agence, une production de savoirs au plus près du projet »
ÉPISTEMOLOGIE / RECHERCHE
Agamben Giorgio, Qu’est-ce que le contemporain ? Paris, Rivages/poche, 2008
Beaud Michel, L’art de la thèse, Comment préparer et rédiger un mémoire de master, une thèse de doctorat ou tout autre travail universitaire à l’ère du net, Paris, La Découverte, 2006
Bernard Claude, L'Introduction à l'étude de la Médecine expérimentale, 1865, gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k3812d/f5.item
Deleuze Gilles : « Qu’est-ce que l’acte de création ? » www.webdeleuze.com (consulté le 12/08/2015)
Dewey John, L’art comme expérience, Gallimard, 2010 (ed. orig. 1934)
Hartog François, Régimes d'historicité, Présentisme et expériences du temps, Paris, Seuil, 2003
James William, Le pragmatisme, Un nouveau nom pour d’anciennes manières de penser, Paris, Flammarion, 2007 (ed. orig. 1907)
James William, Philosophie de l’expérience. Un univers pluraliste, Les Empêcheurs de penser en rond, Paris, 2007 (ed. orig. 1909)
Jencks Charles, Silver Nathan, Adhocism : The Case for Improvisation. Cambridge (Mass), London, MIT Press, 2013
Latour Bruno et Woolgar Steve, La vie de laboratoire : la production des faits scientifiques, Paris, La découverte, 1988
Lévi-Strauss Claude, La pensée sauvage, Paris, Plon, 1962
Popper Karl R., Conjectures et réfutations, La croissance du savoir scientifique, Paris, Payot, 1985
+
Findeli Alain, « La recherche-projet : une méthode pour la recherche en design », Bâle, 2005, [en ligne] projekt.unimes.fr/files/2014/04/Findeli.2005.Recherche-projet.pdf ; Findeli Alain et Coste Anne, « De la recherche-création à la recherche-projet : un cadre théorique et méthodologique pour la recherche architecturale », Lieux commun, 10, 2007 _ projekt.unimes.fr/files/2014/04/Findeli-Coste.pdf
Grosjean Bénédicte (dir.) : « Recherche et projet : productions spécifiques et apports croisés », in Actes du 2ème séminaire inter-écoles Vile, territoire, paysage (nov. 2016), EnsapL, 2018
Grosjean Bénédicte : « Entre recherche et projet : définir un territoire 'transfrontalier' », mémoire de Hdr, 2019, ED Sesam, Laboratoire Lacth
Guenot Mélanie : « Entre ethos professionnel et logiques d’entreprises : La recherche et l’innovation dans les agences d’architecture », Les Cahiers de la recherche architecturale urbaine et paysagère [En ligne], 9|10 | 2020, mis en ligne le 28 décembre 2020
Hanrot Stéphane, note de présentation des Actes des Rencontres doctorales en architecture 2015 (03 au 05 sept. 2015, Ensa Marseille) : « Quels rapports entre recherche et projet dans les disciplines de l'architecture, de l'urbanisme, Du paysage et du design ? » fr.calameo.com/books/00336801660748e4dc243
Huyghe Pierre-Damien, Contre-temps. De la recherche et de ses enjeux : arts, architecture, design, Paris, B42, 2017
Laporte Rémi : « Notes sur la part d’imitation dans l’innovation en architecture », Les Cahiers de la recherche architecturale urbaine et paysagère [En ligne], 1 | 2018. URL : journals.openedition.org/craup/282 ; DOI : doi.org/10.4000/craup.282
Rambert Frank : “Architecture, la recherche par le projet”. fabricA, École nationale supérieure d'architecture de Versailles (énsa-v), 2019. ⟨hal-03190732⟩
Rollot Mathias, La recherche architecturale. Repères, outils analyses. Montpellier, ed. de l’Espérou, 2019
Till, Jeremy, Architecture depends, Londres, The MIT Press, 2009
COMMUNS / ÉCOPOLITIQUE
Acosta Alberto, Demaria Federico, Escobar Arturo, Kothari Ashish, Salleh Ariel, (dir.), Plurivers, Un dictionnaire du post développement, Marseille, Wildproject, 2022 (ed. orig. 2019)
Alix Nicole, Bancel Jean-Louis, Coriat Benjamin, Sultan Frédéric (dir.), Vers une république des biens communs ? Paris, Les liens qui libèrent, 2018
Bacqué Marie-Hélène, D'alternatives et de communs, Presses universitaires de Paris Nanterre, 2022
Bonneuil Christophe et Fressoz Jean-Baptiste, L’Évènement anthropocène, l’histoire et nous, Paris, Seuil, 2013
Bourg Dominique, Joly Pierre-Benoît et Kaufmann Alain (dir.), Du risque à la menace. Penser la catastrophe, Paris, Puf, 2013
Charbonnier Pierre, Abondance et liberté. Une histoire environnementale des idées politiques, Paris, La Découverte, 2020
Coriat Benjamin (dir.), Le retour des communs, la crise de l’idéologie propriétaire, Paris, Les liens qui libèrent, 2015
Dardot Pierre et Laval Christian, Commun, essai sur la révolution au XXIe siècle, Paris, La Découverte, 2014
Descola Philippe, Par-delà nature et culture, Paris, Gallimard, 2005
Haraway Donna, Vivre avec le trouble, Vaulx-en-Velin, Ed. des Mondes à faire, 2020 (ed. orig. 2016) ; Habiter avec le trouble avec Donna Haraway (Textes réunis et présentés par Fl Caeymaex, V Despret et J Pieron), Ed. Dehors, 2019
Ingold Tim, Marcher avec les dragons, Bruxelles, Zone sensible, 2013
Lacroix Bernard, Pailhès Anne-Marie, Rolland-Diamond Caroline, Landrin Xavier : Les contre-cultures, genèses, circulations, pratiques Paris, Sylepse, 2015
Latour Bruno, Nous n’avons jamais été modernes, Essai d’anthropologie symétrique, Paris, La découverte, 1991
Latour Bruno, Gaïa. Huit conférences sur le Nouveau Régime Climatique, Paris, La Découverte, 2015
Laval Christian, Sauvêtre Pierre, Taylan Ferhat (Dir.), L'alternative du commun, Paris, Hermann, 2019
Leopold Aldo. L’éthique de la terre, Paris, Payot et Rivages, 2019 (ed. orig. 1933-39-47)
Morizot Baptiste, « Nouvelles alliances avec la terre. Une cohabitation diplomatique avec le vivant », Tracés. Revue de Sciences humaines [En ligne], 33 | 2017, URL : journals.openedition.org/traces/7001 ; DOI : doi.org/10.4000/traces.7001
Nicolas-Le Strat Pascal, Le travail du commun, Éditions du commun, 2016
Ostrom Elinor, Gouvernance des biens communs, pour une nouvelle approche des ressources naturelles, Louvain-la-Neuve, 2010 (ed. orig. 1990)
Sennett Richard, Ce que sait la main. La culture de l’artisanat, Paris, Albin Michel, 2010
Simondon Georges, Du mode d’existence des objets techniques, Paris : Aubier, 1958 (réed. 1989)
Simondon Gilbert, « Réflexions sur la techno-esthétique », in Sur la Technique, 1953-1983, Paris, PUF, 2014
Truong Nicolas : « Le tournant écopolitique de la pensée française », Le Monde, 02/08/2020
Vanuxem Sarah, La propriété de la terre, Marseille, Wildproject, 2018
+
Doutriaux Emmanuel, Conditions d’air. Politique des architectures par l’ambiance, Genève, MétisPresses, 2020
Durand Béatrice : « La fabrication d’une architecture “durable” en France (2000-2010) ”, thèse de doctorat, Ensa Paris-Belleville/Ipraus/Paris-Est, dir. C. Maniaque, 2023
Lopez Fanny, Le rêve d’une déconnexion, de la maison à la cité auto-énergétique, Ed de la Villette, 2014
Mosconi Léa : « Émergence du récit écologiste dans le milieu de l’architecture ; 1989 - 2015 : de la réglementation à la thèse de l’anthropocène », thèse de doctorat, UMR AUSser 3329 Ensa Paris-Malaquais (dir. JL Violeau), 2018