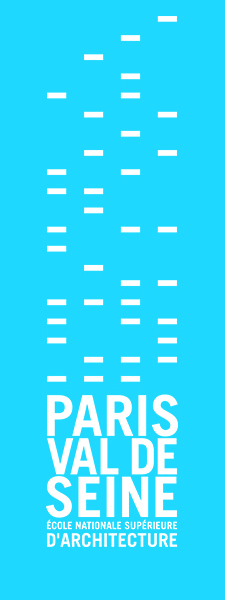REPERES BIBLIOGRAPHIQUES
BIBLIOGRAPHIE GENERALE
AMSELLE (Jean-Loup) “Ethnie”, in Encyclopaedia Universalis, 2004
COLLECTIF Espaces des autres – Lectures anthropologiques d’architectures, Paris, Editions de la Villette,1987
CORBOZ (André) Le Territoire comme palimpseste et autres essais, Editions de l'imprimeur, 2001
CRESSWELL (Robert) Eléments d’ethnologie 2 – Six approches, Paris, Armand Colin, 1975
CONDOMINAS (Georges) « Pour une définition anthropologique du concept d’espace social », ASEMI, CNRS-EHESS, vol VIII, n°2, 1977
DELMOTTE (Benjamin) L'architecture au subjonctif - Une phénoménologie de l'espace et de son aménagement, Bruxelles, 2018
DEPAULE (Jean-Charles) et ARNAUD (Jean-Luc) A travers le mur, CCI, Centre Georges Pompidou, 1985
DEPAULE (Jean-Charles) NOWEIR (Sawsan) Balcons au caire. Les relations de l’intérieur et de l’extérieur dans l’habitat populaire. Architecture et comportement, n°3-4, 1986
DEPAULE (Jean-Charles) L’anthropologie de l’espace , Cahiers du PIR Villes, CNRS Editions, Paris, 1995, p.15-74
DIBIE (Pascal) Ethnologie de la chambre à coucher, Paris, Grasset, 1987
DIBIE (Pascal) Ethnologie de la porte, Paris, Métailié, 2012
GERAUD (Marie-Odile), LESERVOISIER (Olivier) POTTIER (Richard) Les notions-clés de l'ethnologie, Paris, Armand Colin, 2002
GILLET (Alexandre) Dérives atopiques in espacestemps.net, 2006 (https://www.espacestemps.net/articles/derives-atopiques/?output=pdf)
GODELIER (Maurice) Les tribus dans l’histoire et face aux états, Paris, CNRS, 2010
HAUMONT (Bernard) MOREL Alain (dir.) La Société des voisins. Paris : Éditions de la Maison des Sciences de l’Homme, 2005
INGOLD (Tim) Une brève histoire des lignes, Zones sensibles, 2013
LAPLANTINE (François) Quand le moi devient autre : Connaître, partager, transformer, Paris, CNRS, 2012
LEVI-STRAUSS (Claude) Race et Histoire, Paris, Gallimard, 1987 [1ère édition 1951]
LEVI-STRAUSS (Claude) La pensée sauvage, Paris, Plon, 1993 [1962]
LEVI-STRAUSS (Claude) La voix des masques, Paris, Plon, 1979
LOUBES (Jean-Paul) Traité d'architecture sauvage, Paris, Editions du Sextant, 2010
OLIVER (Paul) Encyclopaedia of Vernacular Architecture of the World, Cambridge University Press, 1997
MERCIER (Paul) Histoire de l’anthropologie, Paris, PUF, 1966
PAUL-LEVY (Françoise) et SEGAUD (Marion) Anthropologie de l’espace, Paris, Editions du CCI, 1983
RAPOPORT (Amos) Pour une anthropologie de la maison, Paris, Dunod, Aspurb, 1996 [1ère édition 1972]
RIVIERE (Claude) Introduction à l’anthropologie, Paris, Hachette Supérieur, 1995
SCUBLA (Lucien) Donner la vie, donner la mort, psychanalyse, anthropologie, philosophie, Paris, Le bord de l'eau, 2014
SEGAUD (Marion) Anthropologie de l'espace : Habiter, fonder, distribuer, transformer, Paris, Armand Colin, U Sociologie, 2008
WARNIER (Jean-Pierre) Douze leçons d’ethnologie, Université Paris V René Descartes, non publié, 1986-87
WATERSON (Roxanna) The Living House - An Anthropology of Architecture in South-East Asia, Singapour, Oxford University Press, 1994
BIBLIOGRAPHIE THEMATISEE
1- TRADITION ET MODERNITÉ
AGAMBEN (Georgio) Qu’est-ce que le contemporain ? Paris, Rivages, 2008
CORBOZ (André) Sortons enfin du labyrinthe, Gollion, InFolio, 2009
De DIJN (Herman) Modernité et tradition – Essai sur l’entre-deux, Paris, Peeters-Vrin, 2004
JENKS (Charles) The New Paradigm in Architecture: The Language of Post-Modernism, Yale University Press, 2002 [1977]
LATOUR (Bruno) Nous n’avons jamais été modernes. Essai d’anthropologie symétrique, Paris, La Découverte, 2005
LENCLUD (Gérard) “La tradition n’est plus ce qu’elle était”, Terrain, n° 8, octobre 1987
MONDZAIN (Marie-José) La mode, Bayard, 2009
POUILLON (Jean) « Tradition : transmission ou reconstruction » in Fétiches sans fétichisme, Paris, Maspéro, 1975
POUILLON (Jean) « Tradition » in Dictionnaire de l’ethnologie et de l’anthropologie, sous la direction de Pierre Bonte et Michel Izard, Paris, PUF, 1991
2- TECHNIQUES et SOCIETES
BALFET (Hélène) Technologie in Robert Cresswell Eléments d'ethnologie 2 - Six approches, Paris Armand Colin, 1975, pp.44-79
GLASSIE (Henry) Vernacular Architecture, Bloomington, Indianapolis, Indiana University Press, 2000
HERLE (Peter) WOZNIAK (Anna) Tibetan Houses - Vernacular Architecture of the Himalayas and Environs, Bâle, Birkhauser, 2017
IZARD (Jean-Louis) Archi bio, Marseille, Parenthèses, 1979
LATOUR (Bruno) Petites leçons de sociologie des sciences, Paris, La découverte, 2007
LEMMONIER (Pierre) « L’étude des systèmes techniques, une urgence en technologie culturelle » in Techniques et culture 54-55, 2010 : 46-67
LEROI-GOURHAN (André) Le geste et la parole - 1 Technique et langage - 2 La mémoire et les rythmes, Albin Michel, 1964
MAY (John) Buildings without architects - A global guide to everyday architecture, New York, Rizzoli, 2010
OLIVER (Paul) Shelter and Society : New Studies in Vernacular Architecture, Londres, Barrie et Jenkins, 1969
OLIVER (Paul) Dwellings – The Vernacular House Worldwide, New York, Phaidon Press Inc., 2003
RUDOWSKY (Bernard) Architecture without architects, an introduction to nonpedigreed architecture, New York, MOMA, 1966
STEEN (Bill) STEEN (Athena) KOMATSU (Eiko) Built by Hand - Vernacular Buildings around the World, Salt Lake City, Gibbs Smith, 2003
WEBER (Willi) YANNAS (Simos) Lessons from Vernacular Architecture, Londres, New York, Routledge, 2014
3- ORDRE SOCIAL ET SYSTÈMES POLITIQUES - L'ESPACE COMME FIGURE ET INSTRUMENT DU POUVOIR
CLASTRES (Pierre) Malheur du guerrier sauvage Recherches d’anthropologie politique Paris, Le Seuil, 1980
LAURET (Pierre) « Sans image il n'y a pas de logos » - Entretien avec Marie-José Mondzain
Cahiers philosophiques n° 113 printemps 2008 - Théâtre et philosophie
MAUMI (Catherine) 'La grile du National Survey, assise spatiale de la démocratie américaine', Revue de la Société d'études anglo-américaines des XVII° et XVIII° siècles, n° 66, 2009, pp. 117-141
RIVIERE (Claude) Anthropologie politique, Paris, Armand Colin, Collection CURSUS Sociologie, 2000
TESTART (Alain) Eléments de classification des sociétés, Paris, Errance, 2005
4- LE RELIGIEUX - SACRE ET PROFANE - MYTHES ET RITES
AGAMBEN (Georgio) Profanations, Paris, Rivages, 2006
BOYER (Pascal) Et l’homme créa les dieux, Paris, Folio, 2003
DURKHEIM (Emile) Les formes élémentaires de la vie religieuse, PUF Quadrige, 2008 [1912]
ELIADE (Mircea) Le sacré et le profane, Paris, Gallimard Folio Essais, 1987 [1965]
OBADIA (Michel) L'anthropologie des religions, Paris, La Découverte, 2012
RIVIERE (Claude) Socio-Anthropologie des religions, Armand Colin, 1997
TESTART (Alain) Des dons et des dieux - Anthropologie religieuse et sociologie comparative, Paris, Errance, 2006
5- NATURE vs CULTURE
BATESON (Gregory), Vers une écologie de l’esprit, Paris, Seuil, 1977
BEGUIN (François) Le paysage, Paris Flammarion Dominos, 1995
CAUQUELIN (Anne) L’invention du paysage, Paris, PUF, 2013 [1ère édition 2000]
CLUZET (Alain) Les identités vagabondes - Vers un monde standardisé, Gollion, InFolio, 2022
DAGOGNET (François, sous la direction de) Mort du paysage ? Philosophie et esthétique du paysage, Seyssel, Champ Vallon, 1982
DESCOLA (Philippe) Diversité des natures, diversités des cultures, Paris, Bayard, Petites conférences, 2010
DESCOLA (Philippe) « La fabrique des images », exposition Musée du Quai Branly, 2010-2011
DESCOLA (Philippe) L'écologie des autres : L'anthropologie et la question de la nature, Paris, Quae editions, 2011
GONSETH (Marc Olivier), HAINARD (Jacques), KAEHR (Roland) Eds, Natures en tête, Neuchâtel MEN, 1996
INGOLD (Tim) Marcher avec les dragons, Points, 2018
JAKOB (Michael) Le paysage, Gollion, Editions InFolio, 2013
LATOUR (Bruno) « Qu’est-ce qu’un style non moderne ? » in Catherine Grenier (sous la direction de) La parenthèse du moderne. Actes du colloque, 21-22 mai 2004, Editions du Centre Pompidou, Paris, 2005 pp.31-46, 2005
MORPHY (Howard) L'art aborigène, Phaidon, 2003
MOSCOVICI (Pierre) La société contre nature, Paris, UGE, 1972
WACHTEL (Nathan) « Structuralisme et histoire, à propos de l’organisation sociale des Cuzco », in Annales ESC, jan-fév. 1966
THIAW-PO-UNE (Ludivine) Questions d’éthique contemporaine, Paris, Stock, 2006
6- IDENTITÉ - IDENTIFICATION, ASSIGNATION, RELÉGATION, SÉGRÉGATION
CLUZET (Alain) Les identités vagabondes – Vers un monde standardisé ? Gollion, InFolio, 2022
GOUËT (Philippe) L’aventure de l’identité – Fidélité et mouvement, Rennes, Apogée, 2021
DE SUTTER (Laurent) Pour en finir avec soi-même, Paris, PUF, 2021
DETIENNE (Marcel) L’identité nationale, une énigme, Paris, Folio Histoire, 2010
DRAPEAU CONTIM (Filipe) Qu’est-ce que l’identité ? Paris, Vrin, 2010
DUPRONT (Alphonse) in La France et les Français, sous la direction de Michel François, La Pléiade, 1972
GLISSANT (Edouard) Entretien au Monde, 2005
GODELIER (Maurice) Au fondement des sociétés humaines. Ce que nous apprend l’anthropologie, Paris, Albin Michel, Champs Essais, 2007
GOFFMAN (Erving) La Mise en scène de la vie quotidienne, 1. La présentation de soi, Paris, 1973 [1959]
GOFFMAN (Erving) Stigmate. Les usages sociaux des handicaps, Paris, 1975 [1963]
HEINICH (Nathalie) Ce que n'est pas l'identité, Paris, Gallimard, 2018
JEUDY (Henri Pierre) La machine patrimoniale, Belval, 2008
LAPLANTINE (François) Je, nous et les autres, Paris, Le Pommier, 2010
LEVI-STRAUSS( Claude) « Contribution à l'étude de l'organisation sociale des Indiens Bororo », Journal de la Société des Américanistes, 28-2, pp. 269-304, 1936
LEVI-STRAUSS (Claude) Le regard éloigné, Paris, Plon, 1983
7- SÉCURITÉ - SÉCURITAIRE - LA SOCIÉTÉ DE CONTRÔLE
AMY (Sandrine) « Les nouvelles Façades de l’architecture » in Appareil n° 287, 2008
FOESSEL (Michaël) Etat de vigilance - Critique de la banalité sécuritaire, Paris, Le Bord de l'eau, 2010
FOUCAULT (Michel) Surveiller et punir, Paris, Gallimard, 1993 [1ère édition 1975]
GORI (Roland) Faut-il renoncer à la liberté pour être heureux ? Paris, Babel, 2016
HAN (Byung-Chul) Désir – L’enfer de l’identique, Autrement, 2018 [2015]
HAN (Byung-Chul) Psychopolitique – Le néolibéralisme et les nouvelles techniques de pouvoir, Paris, Circé, 2016
LANDAUER (Paul) L’architecte, la ville et la sécurité, Paris, PUF, 2009
LEMEILLEUR (Sandra) L’expressivité de l’intime sur les dispositifs du web: processus de la subjectivité et machinations contemporaines, Thèse de doctorat- Université Bordeaux – Montaigne, 2016
MANGOT (Mickaël) Faut-il consommer pour être heureux ? www.revue-projet.com 2018
MARZANO (Michela) Visages de la peur, Paris, PUF, 2009
RAZAC (Olivier) L'écran et le zoo, Spectacle et domestication, des expositions coloniales à Loft Story, Paris, Denoël, 2002
RAZAC (Olivier) Avec Foucault, après Foucault. Disséquer la société de contrôle, Paris, L’Harmattan, 2008
RAZAC (Olivier) Histoire politique du barbelé, Paris, Flammarion, Champs Essais, 2009
SOULIER (Nicolas) Reconquérir les rues : Exemples à travers le monde et pistes d'actions, Paris, Editions Eugen Ulme, 2012
TABET (Jade) La Résidentialisation du logement social à Paris. Les Annales de la recherche urbaine, n°83-84, sept. 1999, p. 155-163
8- CORPS - MAISON - COSMOS
ARDENNE (Paul) et POLLA (Barbara) « Le corps urbain, un corps à toucher ? » Architecture émotionnelle - matière à penser, Paris, Le bord de l'eau, 2011
BERNARD (Michel) Le corps, Paris, Le Seuil, Points Essais, 1995
BOLOGNE (Jean-Claude) Histoire de la pudeur, Paris, Ed. Olivier Orban, 1986
CARSTEN (Janet) et HUGH-JONES (Stephen) About The House - Lévi-Strauss and Beyond, Cambridge University Press, 1995
CORBIN (Alain) Le miasme et la jonquille, Paris, Flammarion, Champs Histoire, 2008
DETREZ (Christine) La construction sociale du corps, Paris, Le Seuil, Points Essais, 2002
HABIB (Claude) (sous la direction de) La Pudeur : La réserve et le trouble, Paris, Autrement, 1992
HALL (Edward T.) La dimension cachée, Paris, Points Seuil, 1971
LEBRETON (David) La sociologie du corps, Paris, PUF, Que sais-je, 2010
MAUSS (Marcel) 'Les techniques du corps' in Sociologie et anthropologie, Paris, PUF, 1950 [1ère édition 1934]
NG (Cecilia) « Raising the House Post and Feeding the Husbands’ Givers : The Spatial Categories of Social Reproduction among the Minangkabau » Inside Austronesian Houses, edited by James J. FOX, 1993
PERELMAN (Marc) Voir et incarner - Une phénoménologie de l'espace - Corps - Architecture - Paris, Ville, Encre Marine, 2015
SERRES (Michel) Le mal propre, Paris, Le pommier, 2012
VIGARELLO (Georges) Le Propre et le Sale, l’Hygiène du corps depuis le Moyen-Age, Paris, Edit. du Seuil, 1985
9- LA QUESTION DU GENRE - HIÉRARCHIES ET POLARITÉS
BIANQUIS-GASSER (Isabelle) 'Le monde dans la maison - Habitat traditionnel et moderne en République de Mongolie, in Pierre ERNY (dir.) Douze contributions à une ethnologie de la maison, Paris, L'Harmattan, pp. 144-174
CASAJUS (Dominique) 'La tente et le campement chez les Touareg Kel Ferwan', in Revue de l'Occident musulman et de la Méditerranée, Année 1981, Volume 32, Numéro 1 p. 53 - 70
DENEFLE (Sylvette, sous la direction de) Femmes et Villes, Paris, MSH, Tours, Presses Universitaires François Rabelais, 2004
FAURE, E., HERNANDEZ-GONZALEZ, E. et LUXEMBOURG, C. La ville : quel genre ? L’espace public à l’épreuve du genre. Montreuil : Le Temps des Cerises, 2017
HERITIER (Françoise) Masculin / Féminin - La pensée de la différence , Paris, Odile Jacob, 1996
LEGENDRE (Léo) La maison malaise au Kelantan, mémoire de maîtrise, sous la direction de Danièle Geirnaert, Université de Paris X Nanterre, 1993
LIZOT (Jacques) Le Cercle des feux - Faits et dits des Indiens Yanomami, Paris, Seuil, 1976
PEREZ (Patrick) Les indiens hopi d'Arizona - six études anthropologiques, Paris, L'Harmattan, 2004
TESTART (Alain) L'amazone et la cuisinière, anthropologie de la division sexuelle du travail, Paris, Gallimard, 2014
10- FONDER, ORIENTER - LIEUX, LIMITES ET SEUILS
AUGE (Marc) Non-lieux, introduction à une anthropologie de la surmodernité, 1992
BADEL (Christophe) Fondation de villes, Paris, La Documentation Française, 2012
BERDOULAY (Vincent), ENTRIKIN (J.Nicholas) « Lieu et sujet » In Espace géographique, tome 27, n°2, 1998. pp. 111-121
BONNIN (Philippe) 'Dispositifs et rituels du seuil : une topologie sociale. Détour japonais' Communications, n°70, 2002, p. 65-92
BONNIN (Philippe) 'Pour une topologie sociale' in Communications 87, 2010, Autour du lieu, 2010, p. 43-64
CENTLIVRES (Pierre) Rites, seuils, passages, Communications, vol 70 n° 1, p. 33-44, 2000
COLLECTIF Le sens du lieu, Bruxelles, Editions Ousia, 1996
CORBOZ (André) Deux capitales françaises; Saint Petersbourg et Washington, Gollion, InFolio, 2003
DEBARBIEUX (Bernard) 'Le lieu, le territoire et trois figures de rhétorique' in Espace géographique, tome 24 n°2, 1995, p. 97-112
DETIENNE (Marcel, sous la direction de) Tracés de fondation, Paris, Louvain, Peeters, 1990
DIVORNE (Françoise) Berne et les villes fondées par les ducs de Zähringen au XII° siècle, Archives d'Architecture Moderne, 1998
DUPRONT (Alphonse) « Au commencement, un mot : lieu. Étude sémantique et destin d’un concept »
in Hauts Lieux : une quête de racines, de sacré, de symboles, Paris, Autrement, 1990
GENTELLE (Pierre) 'Haut lieu', in Espace géographique, tome 24, n°2, 1995
HELMER (Etienne) Ici et là, une philosophie des lieux, Paris, Verdier, 2019
JULLIEN (François) L'écart et l'entre - Leçon inaugurale de la Chaire sur l'altérité, Paris, Galilée, 2012
LUSSAULT (Michel) Hyper-Lieux, les nouvelles géographies de la mondialisation, Paris, Seuil, 2017
MANGIN (David) La ville franchisée, formes et structures de la ville contemporaine, Paris, Editions de la Villette, 2004
PAUL-LEVY (Françoise) « La croix territoriale : une figure sans histoire » in POIESIS n°4, 1996
ROSSELIN (Céline) 'Entrée, entrer. Approche anthropologique d’un espace du logement' Espaces et sociétés, n°78, 1995
URBAIN (Jean-Didier) « Lieux, liens, légendes » in Le sens du lieu, collectif, Bruxelles, Ousia, 1996, p. 99-107
VAN EYCK (Aldo) 'Whatever Space and Time Mean, Place and Occasion mean more' in Forum, n°4, Amsterdam, 1960
VAN GENNEP (Arnold) Les rites de passage, Paris, Picard, 2011 [1ère édition 1909]
SIBERT (Serge) et LOUBES (Jean-Paul) Voyage dans la Chine des cavernes, Paris, Arthaud, 2003
VON MEISS (Pierre) De la forme au lieu + de la tectonique, Lausanne, PPUR, 2012