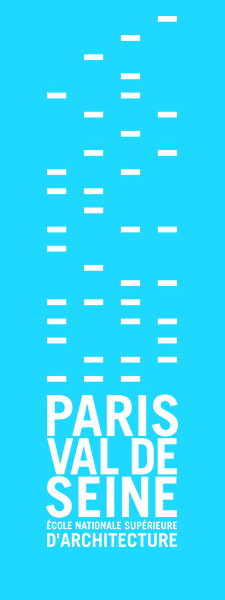Le grand enjeu pédagogique de ce séminaire est de permettre aux étudiants qui s’intéressent à l’ancien (architecture, ville, territoire) d’être en mesure de le comprendre, de l’analyser, de le diagnostiquer afin de définir une éventuelle stratégie d’intervention (sauvegarde, restauration, destruction partielle ou totale, mais aussi projet). L'objectif est que les étudiants développent une expertise sur l’existant (déjà-là) qui doit leur permettre de proposer des préconisations d’interventions, mais aussi une culture des réalisations qui seront autant de pistes de réalisation de projets contemporains s’inspirant des techniques anciennes. En complémentarité de cet objectif, l'étudiant sera amené à documenter et argumenter son travail tandis que ses réflexions et questionnements seront appelé à être nourris grâce à des visites, rencontres avec des intervenants extérieurs, discussion avec les enseignants du séminaire et entre étudiants.
Qu'est-ce que le mémoire ? conditions pour intégrer ce séminaire en master 1 :
L'objectif du séminaire est de vous préparer à développer votre pensée personnelle et critique vis à vis des enjeux d'aujourd'hui. Vous devrez écrire un mémoire qui sera étayé par des sources vérifiées, citées explicitement et puisées parmi les ouvrages et des études à jour (notes de bas de pages et bibliographie). C'est pourquoi chaque séance de séminaire se termine par un exercice méthodologique ou un tour de table des avancements de chacun pour vous aider. L'assiduité est évidemment gage d'évolution et de suivi par les enseignants du séminaire (en master 1).
Les thématiques étudiées dans le mémoire seront de préférence liées aux matériaux bio et géo sourcés, aux méthodes de construction qui en sont issues, le plus souvent traditionnelles ou vernaculaires, sans bien sûr oublier les méthodes plus récentes qui réactualisent ces savoir-faire. L'objet d'étude peut être un matériau, une construction, un ensemble urbain tel qu’un quartier, ou même un territoire. L'adoption d'une perspective historique reste importante, voire essentielle, dans la manière d'aborder ces sujets, non pas comme un préambule mais comme faisant partie de la réflexion.
Les aires géographiques étudiées dans le cadre du mémoire doivent se situer :
1) de manière accessible pour que les étudiants puissent s'y rendre par eux-mêmes au cours du master 1 (grandes vacances incluses). Le travail de terrain n'est pas optionnel, il est indispensable, car c'est l'assurance d'un mémoire personnel (la production de relevés, de comparaison graphiques (photographique ou dessinée), d'entretiens avec les habitants ou avec les acteurs sur place)
2) après cette condition, l'aire géographique étudiée peut se situer de préférence en France, en Europe ou autour de la Méditerranée. Pour les étudiants en mobilité sortante Erasmus, un cas d'étude dans le pays d'accueil peut être envisagé, si la maîtrise de la langue est suffisante.
Mettez-vous dans la peau d'un détective qui mène une enquête, ou un journaliste d'investigation qui
1) cible un sujet atteignable par l'étudiant en 3 semestre et qui l'intéresse
2) trouve les auteurs qui ont étudié ce sujet avant lui et les lis
3) se confronte à l'objet lui-même par le regard (en présentiel !), le redessin (outil majeur du futur architecte), la prise de vues, la cartographie, etc.
4) trie des informations quitte à recentrer le sujet d'étude qui s'avère parfois trop important pour le temps imparti (il ne suffit pas d'accumuler, il faut aussi trier!)
5) rédige progressive sur plusieurs mois un texte de 120 000 signes minimum (cf. Règlement des études), documenté, sourcé, et alimenté des productions personnelles (carto, dessin, interview, photo, etc.). Les images du mémoire sont des documents à part entière et légendés.
Le contenu généré par l’IA peut être incorrect et est une démission au profit d'une pensée passe-partout, sans prise de position personnelle ni de recul critique. Le travail du mémoire, aidé par le suivi du séminaire et des exercices proposés, sont là pour vous y aider.
Exemples de sujet de mémoire (liste non exhaustive):
- Mise en perspective de la notion de confort thermique : le cas du bâti paysan du plateau de Millevaches (Limousin).
- Habiter le patrimoine, le cas de la vallée du M'zab (Algérie)
- La filière Lauze dans les Causses
- L’hôtel d’Herbouville à Paris : histoire, forme et usages d’un hôtel particulier du Marais
- Les granges foraines de la vallée du Biros, étude du hameau de Bertrand (Pyrénées)
- Un bâtiment, plusieurs histoires : l'exemple du 37 rue des Maréchaux à Pontoise
- Le patrimoine juif dans le quartier du Tnaker à Casablanca : la synagogue.
- La reconversion de la halle SUDAC (PVS) : quel parti choisir ?
- la reconversion du patrimoine en Argentine : le cas du couvent de Recoleta à Buenos Aires