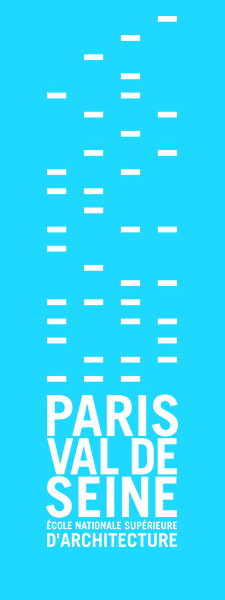Le spectre est entendu ici comme l'atmosphère qui hante un lieu (ou un édifice) où s'est déroulé un événement (ou une série d'événements) impliquant une foule : une révolte, une fête ou la destruction d'un immeuble qui bouleverse la forme spatiale, autant que la structure sociale du lieu.
Il peut s'agir d'événements historiques comme la Commune de Paris et ses barricades, les Gilets Jaunes et les ronds points occupés, ou plus récemment, les J.O. et les infrastructures et équipements sportifs dont on oublie déjà les traces. Il peut aussi être question de bâtiments disparus, comme le cimetière des Innocents, les halles centrales de Baltard, ou les abattoirs de la Villette, les anciennes carrières des Buttes Chaumont.
Nous vous proposons de faire projet en partant des spectres qui habitent un lieu. L'intervention architecturale aura alors comme vocation de retourner l'événement négatif du passé en programme positif pour le futur, tout en conservant quelque chose de la négativité des spectres du passé.
L'atelier sera conduit en trois étapes : une première phase d'enquête sur le terrain, une seconde phase de travail à partir de références architecturales, une dernière phase de conception architecturale.
Phase 1 – Territoires fantomatiques (5 semaines dont l'intensif de départ)
Vous partirez de l'expérience d'un terrain que vous choisirez vous-mêmes, à Paris, ou dans tout autre lieu qui vous est accessible. Ce terrain doit être porteur d'un événement ou d'une série d'événements impliquant une foule d'individus, isolés ou formant un collectif. Sur le terrain, vous chercherez à trouver les lieux et les architectures qui ont gardé des traces de ces événements. Foules oppressées, foules déplacées, foules révoltées, de foules festives...
Dans un premier temps, le terrain donnera lieu à un travail d'arpentage et d'enquête, par le dessin, par l'image et le son. Vous serez attentif.ve.s aux sons et aux images fugaces, à ce que l'on devine derrière les murs, sous la surface des sols. L'enjeu de l'arpentage est de révéler la manière dont l'espace public et les édifices, leurs sols, leurs façades, deviennent le support d'enregistrement des événements. De chercher dans les matériaux, les formes et les espaces architecturaux, la mémoire des événements.
La recherche des symptômes par l'arpentage du site physique sera complétée par l'étude en bibliothèque et sur internet de son archive visuelle et de ses récits historiques, de ses mémoires individuelles et collectives.
Phase 2 – Références externes et déplacements fantomatiques (4 semaine)
Cette seconde phase aura comme enjeu de confronter les architectures spectrales issues du terrain d'enquête avec des architectures venant d'autres lieux et d'autres temps. Si une première spectralité venait du site et de ses temporalités, vous chercherez à voir comment ces spectres peuvent se déplacer d'un lieu à un autre, communiquer avec d'autres spectres, en ayant comme repère non plus le lieu premier, mais le type architectural lui-même.
Parmi une série de références architecturales et artistiques proposées par les enseignant.e.s, vous choisirez des projets d'édifices, d'espaces publics et des fragments d'architecture analogues à ceux dessinés à la fin de la phase 1. (Le choix des référence peut être augmentée par des références personnelles adéquates avec le récit issu de la première phase.)
Tout en se basant sur les similarités formelles, spatiales et constructives entre les éléments issus du terrain et les références venant d'ailleurs, l'enjeu de cette étape est de déplacer le regard, de transfigurer et de travestir les premiers éléments architecturaux venus du terrain. De les habiter par les spectres d'événements et de foules venus d'ailleurs.
Phase 3 – Projet d'une architecture spectrale (5 semaine)
La troisième et dernière phase de l'atelier vous verra travailler à la conception d'un projet en partant de vos récits et des éléments architecturaux issus des deux premières phases. Votre intervention consistera à transformer l'existant en y intégrant les nouveaux fragments issus de vos hybridations fantomatiques. Cette intervention par fragments peut transformer de manière radicale la morphologie urbaine et le visage de l'architecture des lieux. Elle doit en tout cas avoir un impact important et visible sur l'appropriation de l'architecture et des espaces publics par des foules qui répondent aux événements passés et à leurs spectres.
Vous devrez proposer une réponse « positive » à la présence négative des spectres du passé : retourner l'événement négatif en programme positif. Il ne s'agirait pas pour autant d'effacer cette négativité en concevant par exemple des lieux dits « de mémoire » qui étoufferaient l'événement par une forme sur-signifiante. Le spectre qui fuit toujours au regard et à la pensée ne doit pas être remplacé par un symbole architectural déterminant une fois pour toute la signification du lieu et de son histoire. Votre projet doit conserver quelque chose du spectre et des conflictualités dont il témoigne, tout en proposant un espace d'existence plus désirable pour les foules au présent, et peut-être pour les foules dans le futur.