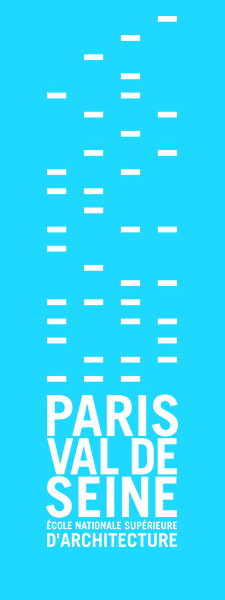Territoires fragiles autour de la Méditerranée
Patrimoines en mutation
Projet Long S9/S10
Equipe pédagogique : Sébastien Mémet, Mathieu Mercuriali, Rita Khalaf et Paolo Tarabusi.
Cours les vendredis
Introduction :
Cet enseignement représente la continuation et le développement d’un cycle d’études et de workshops de Master1 et 2 démarré en 2020 à Alger et poursuivi les années suivantes à Mossoul, Beyrouth, Alexandrie puis AlUla en Arabie Saoudite.
Pour chacune de ces expériences (hormis pour Mossoul réalisée pendant l’année de confinement sanitaire) un partenariat avec une Université locale a été établi afin de réaliser un workshop sur place, ainsi qu’un jury commun en fin de semestre.
Il s’agit d’une expérience pédagogique et humaine riche, qui repose sur la compréhension de patrimoines anciens, exemples bioclimatiques à comprendre et à réinterpréter, et de problématiques complexes et sur la confrontation d’idées, imaginaires et approches pédagogiques différentes.
Caractérisées par des changements climatiques et sociétaux rapides, une démographie en forte hausse et un milieu très fragile et de grande valeur patrimoniale, les villes méditerranéennes peuvent être aujourd’hui considérées comme des laboratoires d’expérimentation et de résilience exemplaires pour le monde à venir.
Objectifs pédagogiques :
L'objectif pédagogique principal de cet enseignement est la mise en place d'un cheminement cognitif d'analyse et de diagnostic qui saisit les données, les organise et les hiérarchise pour en faire ressortir les enjeux qui amènent à une stratégie d’intervention fondée.
Cela porte aussi bien sur la grande échelle urbaine et territoriale que sur l’aspect socio-culturel du pays dans lequel on intervient. La compréhension du territoire, son paysage, topographie et hydrographie, ainsi que son urbanisme en relation au développement démographique, la situation politique, économique et sociale, vont créer le substrat permettant la compréhension des principales problématiques locales.
La question qui se pose en suite face à l’ampleur des problématiques du contexte est principalement celle du rôle de l’architecture et de l’urbanisme. Que peut apporter le projet aux mécanismes de modification urbaine, territoriale et sociétale en cours dans ces territoires ? Que peut réellement faire l’architecture pour répondre aux besoins le plus urgents, pour améliorer les relations et donner forme à des situations problématiques tout en s’inscrivant dans le réel ?
Convaincus qu’il est nécessaire de réinventer les façons d’agir de notre profession et, en conséquence, de son enseignement, cette étape amène l’étudiant à réfléchir à la notion « d’utilité » invitant à mettre d’à côté toute solution préétablie ainsi que les formalismes stériles.
Le S9 se termine par la définition et la mise en forme de stratégies de réflexion ainsi que d’un ou plusieurs périmètres possibles d’intervention sur lesquelles des premières esquisses sont testés et analysés. Le travail est prioritairement réalisé en groupe, sous forme d’atelier, avec des échanges constants afin de partager les informations et confronter les idées. Les relations avec les étudiants et enseignants des autres écoles et Universités françaises et étrangères seront maintenues pendant la durée du semestre.
Par la suite le S10 porte à la définition du projet de PFE. Qu’il soit à l’échelle d’un quartier ou d’une architecture il s’appuie sur les connaissances acquises pendant le S9. L’intervention architecturale se fait avec le déjà là et le disponible. Dans un souci d’ancrage dans le réel, chaque proposition est questionnée pour son utilité, sa faisabilité technique et financière en relation aux disponibilités, aux cultures et traditions vernaculaires et aux savoirs locaux.
Le travail de ce semestre est prioritairement réalisé en binôme bien que des échanges constants sont mis en place sous forme de critiques réciproques et de jurys entre étudiants.