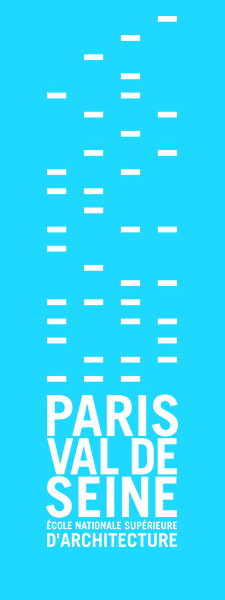Ce séminaire propose d’explorer les manières de cohabiter avec le vivant, de fabriquer des « mondes habitables » (Despret), avec le souci de faire ensemble et de dépasser la dichotomie entre humains et non-humains (Donaldson et Kimlicka).
Pour ce faire, nous proposons de partir de la matière, comme support de réflexion, d’expérimentation et de création. En architecture, la matière contient le visible et l’invisible, la forme et l’esprit, le matériel et l’immatériel, le raisonné et le sensible. Elle se façonne, résiste ou se transforme. Elle accueille nos imaginaires, donne de la substance à l’action et inspire les pratiques. Ce séminaire appréhende donc la matière au-delà de sa dimension physique, pour interroger sa portée poétique, politique, sociale et écologique.
Penser la matière, c’est repenser notre manière d’habiter le monde, c’est reconsidérer notre rapport au vivant, en l’envisageant non plus seulement comme une ressource, mais dans des logiques de coopération et d’alliance (Morizot). Ainsi, le séminaire invite à réfléchir aux savoirs autochtones (Watson), aux technologies low-tech (Mateus et Roussilhé) ou inspirées de la nature, aux pratiques de détournement ou d’adaptation dans des environnements dégradés ou instables (Tsing), pour imaginer de nouvelles formes de coexistence entre les vivants.
Dans une perspective de recherche-création, le séminaire se fonde sur l’idée que le savoir se construit ‘en faisant’ dans une interrelation constante entre le geste et la parole (Leroi-Gourhan), entre faire et penser (Ingold), entre la main, la tête et le cœur (Sennett).