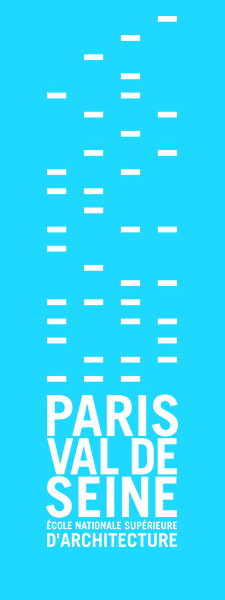Séminaire 2024-2025 : FORME, TYPE, LIEU
Enseignants:
Paolo Amaldi
Giovanna Marinoni
Anne Roqueplo
Adrien Besson
Grégoire Bignier
Martine Weissmnann
Présentation:
Les notions de type et d'archétype renvoient à des modèles architecturaux « forts » qui traversent mutatis mutandis l'histoire de l'architecture. Ce séminaire a pour but d’initier un travail de recherches à partir de l’étude d’un corpus d’œuvres et d’auteurs que choisira librement l'étudiante et l'étudiant et qui recoupe quatre situations géographiquement et culturellement caractérisées.
La première est la Montagne, la seconde la Méditerranée entendue comme littoral, la troisième est le paysage cultivé, périurbain et fortement anthropisé, , la quatrième est une forme d’urbanité méditerranéenne alternative à celle que nous connaissons en Europe occidentale de fondation romaine. Ces quatre situations peuvent d’ailleurs être contiguës, imbriquées voire réunies dans une seule entité ; il suffit d’observer le territoire des Pyrénées orientales ou des Alpes plongeant dans la Méditerranée, en France, et plus largement le socle du bassin méditerranéen, au relief très prononcé, pour constater que mer et montagne ne font qu’un, en produisant les paysages grandioses que nous connaissons tous. Le travail acharné pour domestiquer des pentes abruptes et pour recueillir et redistribuer l’eau sur les cultures en terrasses constitue le premier acte de construction.
Le premier objectif de ce séminaire est d'analyser les relations qui existent entre l'identité d'un territoire - à savoir sa topographie (et son substrat géologique) autant que son climat - et l'édification, sachant qu'aujourd'hui la notion d'infrastructure paysagère n'est plus associée à l'idée d'un artefact lourd et pesant, qui a connu son apogée au XIXème et au XXème. La question sous-jacente est : comment l'homme domestique-t-il un site, comment rend-il habitable les zones les plus inhospitalières ? Mais aussi : comment l'architecture peut-elle faire site ( pensons au thème de la Villa, lieu de repos et de villégiature, qui traverse deux mille ans d’histoire) ? Quelles complémentarités peuvent se jouer entre l’homme, construisant son espace de vie, et la nature en place qui doit être protégée ? Et comment la ville, pour reprendre le mythe développé par des penseurs comme Walter Benjamin, peut être considérée comme un paysage ?
Le deuxième objectif de ce séminaire est de montrer la pertinence territoriale ou climatique d'un édifice en tant que figure architecturale. Qu'est-ce une figure ? C'est un schéma - donc un outil de projet - qui résume les caractères distributif, constructif et spatial d'un objet physique en regard d'un usage et d'une fonction donnée, allant de l'échelle du seuil ou de l’ouverture, jusqu’à l'échelle du paysage. Quelle est la nature du rapport entre le proche et le lointain ? Comment l’objet architectural dialogue-t-il avec les autres objets et composants de l’écosystème en place ?
Le troisième objectif de ce séminaire consiste à mettre en avant les rapports qui se nouent entre des façons d'habiter et traditions constructives. A ce propos, nous intéresserons aux villes du Maghreb, à la Casbah, utilisée par certains architectes du XXème siècle comme Aldo van Eyck pour repenser la notion de ' voisinage 'dans un tissu urbain plus informel et ouvert. Au XXème siècle, au sortir de la deuxième Guerre mondiale, l’architecture moderne s’empare de la Méditerranée tant dans le domaine de l’architecture que de l’urbanisme. Le concept de Nappe, de Cluster et de MAT Building développé à cette époque par Alison Smithson repose sur une nouvelle conception de la ville plus adhérente à certaines préoccupations d'ordre social qui s’inspirent fortement de cet habitat dense du Maghreb et de sa ' clarté labyrinthique '. Nous pensons que ce modèle d’habitation a une grande actualité.
De façon plus large, la nécessaire économie des ressources nous oblige à reconsidérer les formes, les spatialités et les agencements dits « vernaculaires » qui ont traversé l'histoire et qui méritent d'être réactivées et/ou associées dans le processus de renouvellement de la forme et des modes d’habiter plus ouverts et inclusifs.
« Au cours des années, je suis devenu un homme de partout, écrit Le Corbusier en 1965. J'ai voyagé à travers les continents. Je n'ai qu'une attache profonde : la Méditerranée. Je suis un Méditerranéen, très fortement marqué par la Méditerranée, reine de formes et de lumière. La lumière et l’espace. Le fait, c'est le contact pour moi en 1910 à Athènes. Lumière décisive. Volume décisif : l'Acropole. Mon premier tableau peint en 1918, la Cheminée, c'est l'Acropole. Mon Unité d'habitation de Marseille ? C'est le prolongement ».
SEMINAIRE DE DOCTORAT
Paolo Amaldi coordonne le séminaire de doctorat par le Projet intitulé ' Temps et Projet' . Ce séminaire est inscrit dans le laboratoire l'EVCAU
La problématique élaborée dans le mémoire peut s'inscrire dans une vraie recherche et se prolonger, à la fin des études, par une thèse de doctorat.
Marie Prel, doctorante, viendra présenter son expérience de recherche du mémoire au doctorat.