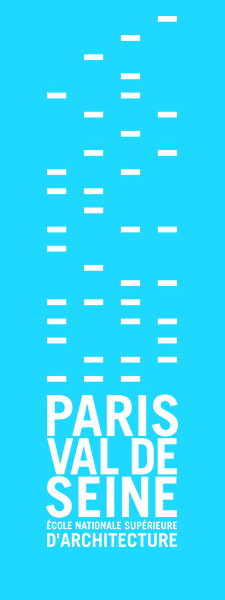ATELIER DE PROJET S7-S9
CHERBOURG - ADAPTER UNE ZONE CRITIQUE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
Équipe pédagogique :
Antoine Barjon, Mathieu Mercuriali, Maya Nemeta (TPCAU)
Corinne Tiry-Ono (VT), Emma Filipponi (HCA), Jean-Marc L’Anton (VT)
Andrea Gritti, architecte et professeur au Politecnico de Milan (POLIMI)
Notre proposition pédagogique s’inscrit dans le domaine d’études INFRASTRUCTURES TERRESTRES, qui porte l’ambition de « préparer nos étudiants.es à agir dans un monde où il est devenu primordial d’atténuer l’impact des activités humaines sur l’environnement au sens large, mais aussi de développer des stratégies d’adaptation face à un réchauffement climatique inéluctable. »*
Au sein du DE, les deux enseignements de projet ont en commun de placer au cœur du sujet la question de l’habitabilité́ terrestre dans un monde marqué par de multiples crises (environnementales, économiques, sociales). Ils s’appuient sur la notion d’infrastructure, notion entendue à la compréhension et l’analyse des systèmes d’installations humaines sur lesquels il est nécessaire que l’architecte agisse pour faire face aux bouleversements actuels. Chaque enseignement est construit autour d’un objet d’étude géographiquement situé, emblématique des grands enjeux portés par l’évolution de nos sociétés. Il vise à produire un « manifeste situé », capable de produire de la connaissance et des outils pour agir à l’aune de la condition présente.
L’enseignement de projet Infrastructures littorales, qui s’adresse conjointement aux étudiants S7-S9, s’intéresse ainsi aux infrastructures situées en première ligne du dérèglement climatique, avec le choix d’une situation littorale différente chaque année. Nous nous intéressons ce semestre aux infrastructures littorales de la ville de Cherbourg et de la presqu’île du Cotentin. A partir de ce terrain d’étude commun, que nous irons arpenter ensemble lors d’un voyage d’étude, l’enseignement de projet laisse ouvert aux étudiants le choix du site et du programme, en lien avec les travaux d’analyse et d’identification des enjeux portés par le séminaire « Les villes côtières face aux crises », porté par la même équipe pédagogique. L’enseignement de projet et le séminaire associé « recherche par le projet » portent ainsi sur le même terrain d’étude et mobilisent tous deux des enseignants des champs disciplinaires TPCAU, HCA et VT. L’inscription simultanée en cours de projet et de séminaire est vivement conseillée sans être rendue obligatoire. Les étudiants qui le souhaitent sont par ailleurs encouragés à poursuivre en S10 un PFE « mention recherche ».
* Texte extrait du «Rapport HCERES, Campagne d’évaluation 2023-2024, Vague D, Axes stratégiques de développement 2025-2030 », juin 2023.