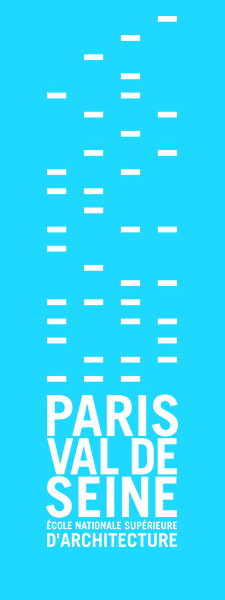L’équipe pédagogique est constituée, en vue d’un effectif d’environ 15 étudiants, de :
- Antoine Viger-Kohler, architecte DPLG, enseignant, TPCAU, responsable S7.
- Eteinne Lenack, architecte DPLG, enseignant, TPCAU, responsable S9.
- Sacha Discors, architecte DPLG, enseignant TPCAU.
- Christel Palant-Frapier, historienne, enseignante HCA.
- Antoine Maufay, architecte, ingénieur, enseignant STA.
Le groupe de S7 travaillera conjointement avec le groupe d'étudiants du S7 d'environ 15 étudiants animé par :
- Etienne Lénack, architecte urbaniste, enseignant TPCA, responsable du S9
- Antoine Maufay, architecte ingénieur, enseignant STA
L'ensemble constitué par les étudiants M1+M2, soit environ 30 étudiants, conduira collectivement une Recherche par le Projet en partenariat avec l’Atelier Parisien d’Urbanisme (APUR).
Le semestre porte sur la connaissance et la transformation d’un corpus d’édifices majeurs de la métropole parisienne : les centres commerciaux. Conçus à partir de la fin des années 1960 et jusqu’aux années 1990, ces ensembles constituent un héritage bâti considérable, occupant de vastes emprises déjà artificialisées et souvent situées au croisement des grands réseaux routiers et ferroviaires.
L’enseignement vise à mobiliser cette matière déjà construite pour inventer de nouvelles stratégies de transformation, capables de répondre aux enjeux environnementaux (réduction de l’empreinte carbone, réemploi, limitation de l’artificialisation), sociaux (ouverture à de nouveaux usages, accueil de programmes publics, création de centralités) et urbains (densification, mixité, intensification à proximité des pôles du Grand Paris Express).
La démarche de projet s’appuiera sur l’apprentissage d’une « connaissance de la matière » (sa provenance, ses caractéristiques, sa composition, ses états de transformation, son impact carbone, son cycle de vie, etc…) pour définir des modes de transformation économes en carbone et en ressources et nécessitant peu d’énergie pour leur maintenance. Elle privilégiera également une forme d’archaïsme pour favoriser le recours à des dispositifs simples et passifs plutôt que des systèmes électriques ou numériques en s’inscrivant dans une compréhension constructive et historique des objets étudiés. Pour cela, cet enseignement sera appuyé par les champs STA et HCA.