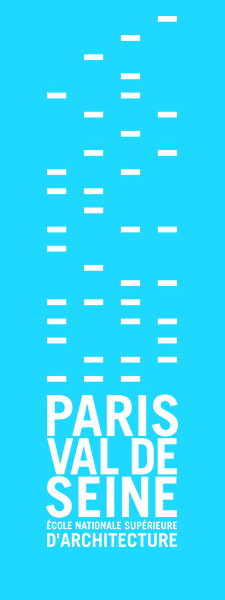Résumé :
L’Atelier du Limousin est un atelier de master en architecture en partie in situ et rattaché à l’École nationale supérieure d’architecture de Paris Val-de-Seine. Véritable enseignement-laboratoire, il vise, dans un territoire rural de la Haute-Vienne, à développer une pédagogie expérientielle située adossée à la recherche universitaire et reliant architecture, (a)ménagement du territoire, paysage et agriculture. Pour les enseignants-chercheurs de l’Atelier du Limousin, il s’agit de réaliser avec les étudiants et les acteurs locaux (collectivités, associations) des projets coopératifs constituant des réponses concrètes aux crises environnementales et sociales contemporaines, et de produire des connaissances et des compétences généralisables dans ces domaines.
En concevant et en réalisant eux-mêmes ces projets d’intérêt général, les étudiants participent à l’élaboration du bien commun tout en étant ambassadeurs de la valeur et des potentiels de l’architecture et des architectes pour les mondes à venir. Depuis 2023, l’Atelier a pour ambition de s’installer à demeure sur son territoire éponyme et d’établir un centre d’enseignement et de recherche en architecture sur la ruralité et la mutation écologique dans une ancienne grange du XIIe siècle. Ce projet pédagogique et de recherche s’inscrit dans l’ambition de la Stratégie Nationale pour l’Architecture de “transformer l’acte de construire de demain” en associant formation, recherche et métiers.
Prérequis :
- Curiosité, force de travail et appétence forte pour les questions éco-sociales radicales, la construction et la ruralité.
- Souhait de participer à un travail en partie coopératif. Bienveillance et désir de partager avec les autres.
- Toute compétence individuelle pouvant enrichir le groupe est bienvenue.
Objectifs pédagogiques généraux :
- Prendre conscience des crises et enjeux écologiques et sociaux contemporains.
- Imaginer et mettre en œuvre des moyens pour résoudre les crises écologiques et sociales contemporaines du point de vue de l’architecture et du ménagement du territoire et des paysages, et plus si possible.
- Concevoir des programmes et usages alternatifs à partir de l’étude d’un corpus spécifique.
- Concevoir un projet dans toutes ses complexités d’usages et de relations au milieu.
- Concevoir la partie symbolique du projet architectural (sens, fonctionnement, composition, organisation, …).
- Concevoir la partie phénoménologique du projet architectural (ambiances/atmosphères dont espaces, matérialités, perceptions et sensations).
- Concevoir la partie architectonique du projet architectural dans ses grands principes (mise au point de la bioclimatique, de la structure, de la construction et des fluides à partir des outils, machines, méthodes, techniques et technologies de l’architecture).
- Représenter en 2D, 3D en maquette et à la main le projet.
Objectifs attendus en termes de compétences cognitives / théoriques (savoir) :
- Comprendre les enjeux de la mutation écologique (paradigme de l'énergie, transformation de la matière, vivant, sociétés humaines) et ses impacts sur la discipline architecturale et le métier d’architecte ;
- Définir à l’oral les principaux mots clés de l’enseignement ;
- Constituer et justifier un corpus de références (carte, projet d’architecture, livre, film, œuvre, poésie, article…) pour faire projet ;
- Convoquer 3 à 5 références fondamentales sur la réutilisation, le réemploi, la réhabilitation et en faire un corpus de projet ;
- Appréhender la complexité d’un milieu et décrire une grille de lecture systémique ;
- Distinguer l’approche documentée-scientifique du milieu de l’approche sensible. Établir le lien entre les deux ;
- Maitriser le processus de conception (définir approche méthodologique et démarche globale à l’oral) ;
- Connaitre le vocabulaire de base de la réutilisation et de la réhabilitation, de l’échelle urbaine au détail 1/10° ;
- Pouvoir décrire l'expérience de l'échelle 1 tant d'un point de vue architectonique, phénoménologique que symbolique.
Objectifs attendus en termes de compétences psychomotrices / techniques (savoir-faire) :
Dans la conception : il est attendu de montrer la capacité de l’apprenant à concevoir et représenter un projet
- Proposer un nouveau récit sociétal visant à porter la mutation écologique et la régénération de notre écoumène ;
- Être capable de porter ce récit au travers d’un récit-projet ;
- Établir le diagnostic d’un lieu du point de vue architectonique : aspects structurels, constructifs, fluides et bioclimatiques.
- Établir le diagnostic d’un lieu du point de vue phénoménologique : ambiances/atmosphères dont espaces, matérialités, perceptions et sensations (lumières, vues, acoustiques, odeurs, textures).
- Établir le diagnostic d’un lieu du point de vue symbolique : composition, proportions, géométries, système de mesure, usages, programmation.
- Raconter l’histoire d’un bâti et son avenir.
- Cartographier un milieu et en déduire constats, diagnostics, affordances et stratégies d’intervention projectuelles sous forme axiomatique et schématique ;
- Convoquer la méthode de diagnostic SWOT adaptée par l’approche mésologique (RCOR) ;
- Développer un argument de conception en s’appuyant notamment sur un corpus (expliquer à partir de quoi, comment et pourquoi un document a été conçu) ;
- Communiquer synthétiquement, distinctement et précisément des concepts et des idées à l’oral, à l’écrit et en représentation (cohérence, sens, conclusions…) ;
- Développer des propositions de projets en lien avec un milieu réel et avec les acteurs locaux, habitants, actifs, associations, élus, etc. ;
- Proposer et préparer les documents de représentation nécessaires à la compréhension complète d’un projet ;
- Représenter le projet techniquement et qualitativement aux principales échelles de travail avec les outils de conception de l’architecture (2D, 3D numérique et analogique, maquettes) ;
- Représenter une série de détails constructifs du 1/50° au 1/5° ;
Dans la fabrication : Les compétences à acquérir ici sont de l'ordre de l'initiation et de la prise en main. Il s'agit avant tout de faire percevoir à l'apprenant la réalité physique de la construction, non pas de le transformer en artisan (même si cette initiation peut ouvrir des vocations). Il s'agira aussi de faire le lien entre ces compétences et les compétences cognitives notamment dans la compréhension du rapport entre la conception et la réalisation à l'échelle réelle.
- Manipuler les outils de fabrication de base (taille de pierre, charpente, menuiserie, terre crue, …)
- Prévoir (planifier, anticiper, organiser, …) ;
- Fabriquer ;
- Mettre en œuvre ;
- Déconstruire ;
Objectifs attendus en termes de compétences affectives / comportementales (savoir-être) :
- Travailler en groupe, s’entraider, collaborer, participer, avoir un esprit de groupe, avoir un esprit d’écoute, savoir écouter et se faire écouter ;
- 0rganiser et diriger le travail en groupe ;
- Respecter la ponctualité, le respect des consignes, le respect des règles de vie et de travail en commun ;
- Animer une réunion publique, de l’organisation au compte-rendu ;