Vers de nouveaux archétypes. Le projet par la matière : le bois, la pierre et la terre.
La cité des musiques au Boulevard de la Villette.
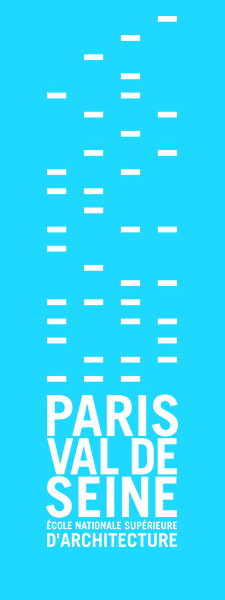
Semestre 5
Groupe 11 - Adrien Besson, Estelle Poisson
Enseignant(s) : Estelle Poisson,Adrien Besson
Vers de nouveaux archétypes. Le projet par la matière : le bois, la pierre et la terre.
La cité des musiques au Boulevard de la Villette.
Thème :
Le démarche de projet visera à explorer l’imaginaire lié aux matériaux vertueux en terme de développement durable : le bois, la pierre et la terre.
La cité des musiques est à la fois une école et un lieu de vie, réunissant infrastructures musicales et logements pour musiciens. Ce dispositif favorise l’échange et enrichit l’expérience musicale, en permettant aussi bien de s’isoler pour travailler que de partager pour créer ensemble.
Équipe pédagogique :
Adrien Besson architecte et docteur ès sciences, co-fondateur de group8 à Genève Suisse. www.group8.ch
Estelle Poisson architecte DPLG. co-fondatrice de l’agence Constellation à Paris. constellations-studio.com
Mots-clés :
Développement durable, matériaux biosourcés, pisé, terre crue, pierre, bois, vérité constructive, sincérité architecturale, architecture durable, réchauffement climatique, impact carbone, circularité, rénovation, archétype.
Objectifs pédagogiques :
Le cycle de Licence constitue le socle fondamental de la formation en architecture. Il a pour ambition de fournir à l’étudiant une culture architecturale, scientifique et technique solide, en le préparant à aborder le projet architectural dans toute sa diversité et sa richesse. Ce cycle permet de consolider les fondamentaux : comprendre les enjeux de l’espace, intégrer les bases de la construction et maîtriser les outils de représentation. La culture du projet vise à forger une pensée structurée, une sensibilité à l’espace et une autonomie progressive. Elle permet également de développer une culture critique de l’architecture et de son histoire. L’introduction à la question des stratégies dans le projet est également centrale : l’étudiant apprend à formuler des intentions claires, à structurer une démarche de projet, et à développer une posture critique capable de proposer des réponses cohérentes.
Objectifs scientifiques
La prise en compte par la société des événements liés au réchauffement climatique demande d’envisager l’acte de construire différemment. C’est le nouveau défi qui se présente à tous les acteurs participant à faire évoluer notre environnement naturel et construit. Un des nouveaux thèmes qui s’offrent à eux est celui de la réduction de l’impact carbone en ayant recours à des matériaux bio-sourcés.
Il ne s’agit pas seulement d’explorer des stratégies de projet en ayant recours à des matériaux vertueux, mais également de former les futurs architectes à adopter une posture critique et résistante face aux enjeux politiques et climatiques, afin que les questions d’espace, de matérialité et de langage architectural demeurent au cœur de tout projet.
Les étudiants seront amenés à aborder et interroger les formes urbaines et les typologies dans le nouveau contexte climatique, avec le regard spécifique de l’architecte. Les aspects techniques et quantitatifs, tels que les calculs d’énergie grise ou l’évaluation de l’impact carbone, ne seront abordés que de manière introductive et non approfondie.
Problématique
Sommes-nous face à une nouvelle sincérité architecturale ? Assistons-nous à l’avènement d’une nouvelle vérité constructive ? Est-ce que les matériaux vertueux en termes de développement durable peuvent produire un nouvel imaginaire architectural ?
Aborder ces questions est une manière de remettre les enjeux de la construction au centre du débat architectural. La fabrique des espaces seront donc conçus mettant en avant le binôme matière/archétype.
Contenu
L’impact carbone, la limitation des ressources, la perte de biodiversité, la circularité et la proximité, et la mutualisation sont les sujets auxquels la société attend des réponses. Pendant des décennies, les constructions « tout en béton » ont permis de s’abstraire de tout raisonnement structurel et constructif. L’espace n’est alors pas contraint par des raisons constructives, car en béton, tout peut être exécuté. Le recours à des matériaux avec des caractéristiques différentes et plus vertueuses du point de vue de l’environnement, tels que le pisé, la terre crue, la pierre, le bois, la paille, et le béton de terre, demande une compréhension fine et sensible de la matière. Le respect strict des caractéristiques de ces matériaux va conférer une identité particulière à une construction, que nous allons explorer.
Les questions liées à la transformation de l’existant, dans la recherche d’une économie de moyens de projet et d’une économie circulaire à favoriser, qui associerait dans le projet à la fois une partie restructurée, mais aussi une partie nouvelle attachée à l’existant, propre à requalifier l’ensemble. Cette problématique de transformation de l’existant engage également des questions historiques dans la redéfinition de l’identité architecturale du projet achevé, et de la capacité de celui-ci à garder les traces du projet initial.
La cité des musiques
La cité des musiques est à la fois une école et un lieu de vie, réunissant infrastructures musicales et logements pour artistes. Elle propose des salles de représentation de tailles variées, dont une grande salle modulable de 1 000 places, des espaces d’accueil du public et des loges ; un pôle de répétition et de création comprenant studios, cabines d’enregistrement, ateliers, espaces pédagogiques, coworking et réserves d’instruments ; ainsi qu’un pôle de résidence offrant une quarantaine de logements et des espaces communs conviviaux. Ce dispositif favorise l’échange et enrichit l’expérience musicale, en permettant aussi bien de s’isoler pour travailler que de partager pour créer ensemble. Ouverte sur la ville, la cité s’accompagne d’une administration, d’un café-restaurant, d’une boutique et des services techniques nécessaires, le tout conçu avec une attention particulière portée à l’acoustique, à la modularité et à la convivialité.
Le site,
Le programme s’implantera dans une parcelle sur le boulevard de la Villette, à la frontière entre les 10ᵉ et 19ᵉ arrondissements. Le projet devra composer avec ce contexte urbain en développant une façade représentative sur le boulevard, tout en ouvrant une partie du programme vers une cour intérieure. Le site accueillant déjà un bâtiment existant, l’intervention portera sur sa transformation et sa réhabilitation, et son extension afin d’y intégrer le programme avec toutes ses caractéristiques. L’opération privilégiera l’usage de matériaux vertueux et durables, dans une logique de respect du patrimoine bâti et de qualité environnementale.
Méthode
La première partie est consacrée à un exercice d’analyse visant à permettre une compréhension fine du sujet, à développer un langage commun, et à mettre en partage les connaissances. Il s’agira notamment de tisser des liens entre des références historiques et des bâtiments contemporains.
Les étudiants seront ensuite individuellement en charge d’un projet, qu’ils développeront jusqu’à la fin du semestre. Chaque étudiant mettra en avant un matériau qu’i explorera dans toutes ses caractéristiques et particularités.
L’encadrement théorique prendra la forme de synthèses méthodologiques, d’exposés théoriques et thématiques, suivis de débats animés par les enseignants. Des cours complémentaires, assurés par des intervenants extérieurs, porteront sur les différentes thématiques abordées dans le projet. Des critiques intermédiaires auront lieu avec des personnalités extérieures invitées pour enrichir la réflexion.
L’atelier se tiendra le vendredi.
Travail en plans, coupes, perspectives, axonométries structurelles, maquettes numériques et maquettes réelles.
Bibliographie sélective
- Cyrille Simonnet, « La vérité constructive : ses articulations, ses effets », faces magazine d’architecture, n°22, 1991.
- Roberto Gargiani, Giovanni Fanelli, « Histoire de l'architecture moderne, structure et revêtement », PPUR, 2008, Lausanne.
- Bearth et Deplazes, « Construire l’architecture, du matériau brut à l'édifice », Birkhäuser Verlag, 2018.