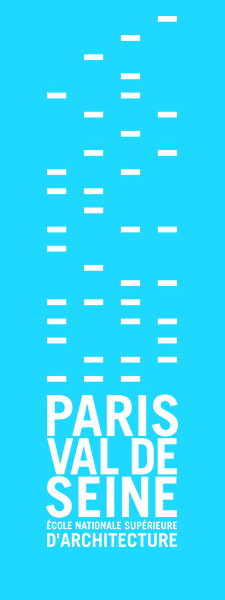GROUPE 8 – SEMESTRE 5
PROJET 1er semestre 2025-26
Enseignant : Dominique Coulon
L’organisation des séances
Jour(s) de la semaine et horaire : Vendredi
Salle(s) : en attente
La pédagogie de l’atelier s’appuie sur un travail à la fois collectif et individuel. Le travail collectif consistera à instaurer un débat au sein de l’atelier afin de mettre en place des stratégies communes qui seront ensuite développées individuellement. L’idée de l’atelier c’est de travailler dans la joie et de mettre en valeur les échanges, les idées, les interrogations aussi.
Nous construirons donc tous ensemble un programme. Un programme qui fera sens mais qui se jouera aussi des contrastes, se nourrissant de la complexité du réel.
L’idée de l’atelier sera de travailler sur des thématiques stimulantes, des thématiques qui soulèveront des questions et qui interrogeront. Ce travail sera collectif. Le travail individuel consistera à développer un scénario personnel.
Parallèlement au déroulement de l’atelier, un travail d’analyse sera demandé. Des groupes seront constitués autour de projets ou bâtiments remarquables. Le principe est de nourrir l’atelier de références qui pourront alimenter le travail du projet. L’analyse sera partiale et subjective. Elle s’affranchira de toute approche scolaire.
Objectifs pédagogiques et acquis d’apprentissage
Le principe pédagogique proposé pour ce semestre consiste à développer une approche différente et nouvelle du processus d’élaboration du projet.
Il s’agit de rendre prédominante la question du programme dans son élaboration et dans son interprétation et de placer cette réflexion au centre de la démarche de projet. Travailler le vide, construire le vide afin de mettre en relation les différents programmes. Voilà ce qui est attendu.
Je propose ici une pédagogie qui s’appuie sur la transversalité avec les autres enseignements. Cet enseignement suggère de travailler en étroite collaboration avec les professeurs informaticiens et ingénieurs.
L’idée est que le projet de L3 devienne le support de travail pour les enseignements annexes. Cette approche transversale comporte l’avantage de lier les différentes disciplines à travers le projet. Elle fait sens. L’étudiant est mis dans une situation d’approche globale vis à vis de son projet.
Pour la première fois dans son cursus, l’étudiant devra analyser et travailler un programme réel. Il devra construire une stratégie programmatique en y apportant sa lecture, sa culture personnelle. Pour cela, nous prenons comme présupposé qu’un programme est porteur de sens et que son interprétation l’est encore plus. L’interprétation d’un programme c’est une prémisse de l’idée architecturale.
L’idée architecturale va précéder la mise en œuvre d’une spatialité particulière suivant une lecture ou une interprétation personnelle du programme. Cette forme pédagogique donne à l’étudiant la capacité de concevoir des espaces en fonction de son interprétation du programme. Pour ce faire, nous proposons de travailler sur des programmes que nous qualifierons « d’ouverts », propices à l’installation de fluidités ou d’imbrications spatiales dont l’étudiant évaluera les fonctionnalités et définira les caractéristiques dimensionnelles à l’intérieur d’un cadre général prédéfini (surface globale imposée par exemple).
Cette élaboration sera conjointe au travail de projet et sera son point de départ, l’objectif étant de révéler la relation fondamentale espace/programme.
Bien entendu, le projet de l’étudiant s’inscrit dans un site réel auquel il devra confronter le travail d’élaboration du programme. Cette démarche pédagogique a pour objet d’amener l’étudiant à prendre conscience de la souplesse possible dans le processus de conception d’un projet.
Il ne s’agit pas d’ériger cette méthode en dogme, mais nous la considérons comme une sorte de gymnastique intellectuelle dont l’exercice s’inscrit dans la volonté d’élaborer une pédagogie qui tourne autour de la maîtrise consciente du projet.
L’approche structurelle, le confort thermique, l’acoustique, la démarche environnementale font partie intégrante de l’atelier. Il s’agit de rendre attentif l’étudiant à la complexité du processus de fabrication du projet en respectant autant que faire se peut les contraintes réglementaires et techniques d’un projet réel (seule la dimension financière n’est pas abordée).
Activités et évènements d’apprentissage
La grande conférence et la journée pédagogique :
L’idée consiste à inviter une personnalité majeure du monde de l’Architecture pour être critique durant une journée de cours et que cette dernière fasse une conférence le soir destinée à l’ensemble de l’école.