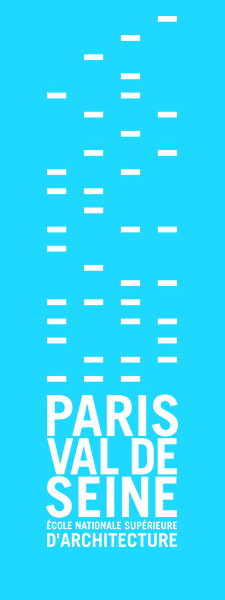FICHE PÉDAGOGIQUE / GROUPE 6 (S5) / UEL 5.11
THÉORIE ET PRATIQUE DU PROJET ARCHITECTURAL ET URBAIN
CONTEXTUALISER (L3) / TRANSFORMER (S5)
(RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DU LOGEMENT COLLECTIF DU XXÈME SIÈCLE)
ENSEIGNANTS
L’équipe pédagogique est constituée de:
• Michel JACOTEY, architecte DPLG et enseignant titulaire (responsable [85 H]);
• Charles-Albert DE BEAUVAIS, architecte DPLG et enseignant titulaire (55 H).
• Iris CHERVET, architecte DPLG et enseignante contractuelle (20 H [jurys]).
ORIENTATIONS PRINCIPALES
Le semestre est l’occasion d’aborder, dans le cadre d’un projet situé de transformation et d’extension d’un ensemble immobilier existant, la thématique de l’amélioration énergétique du patrimoine bâti de l’habitat collectif du XXème siècle, avec la volonté:
• d’insister sur l’expérimentation encadrée d’une méthode de projet faisant une large part au rationnel et à la recherche de sens à chacune des étapes de l’étude;
• d’aborder la représentation architecturale sous l’ensemble de ses aspects (croquis et schémas d’intention, dessin d’étude et de vérification et dessin de présentation);
• d’initier les étudiantes et étudiants à la pratique du projet sous certains de ses aspects les plus opérationnels (méthode de travail, techniques de construction et de rénovation, insertion dans le réel, etc.) en considérant la réalité du construire comme moteur de la conception;
• d’installer, aussi souvent que possible, l’étudiante ou l’étudiant dans une perspective professionnelle en renforçant le lien entre les deux dimensions de l’architecture, discipline et métier.
Ce projet unique, développé pendant tout le semestre, engage chaque étudiant à:
• aborder, avec un esprit « militant », un programme à valeur d’exemplarité, profondément marqué par l’actualité mondiale (amélioration énergétique du patrimoine bâti) et en lien direct avec la problématique du développement durable et de la lutte contre le réchauffement climatique (bâti existant français responsable, à lui seul, d’un quart des émissions nationales de gaz à effet de serre);
• de transformer en profondeur la typologie, souvent obsolète, pour ce patrimoine vieux de presque 50 ans, du logement collectif existant en introduisant des degrés de liberté et des pistes d’innovation portés, d’une part, par les principes de la rénovation énergétique avec densification et, d’autre part, par le caractère innovant et « expérimental » du programme d’un lieu de vie (habitation et travail) destiné à de jeunes adultes (étudiantes et étudiants, etc.);
• s’initier à la notion de réécriture architecturale contrôlée, respectueuse du « génie du lieu » (remarquable en l’occurrence au regard de la production de l’agence ANGER-HEYMANN) et évitant le palimpseste, traduite jusqu’au détail constructif, technique et architectural, pour lui conférer une véritable légitimité;
• de réfléchir, à l’occasion d’un programme de lieu de vie collectif, au statut de l’occupant et à l’interactivité directe entre l’organisation de espace d’habitation et d’activité et son comportement social (au regard notamment de la tranche d’âge de ses futurs usagers);
• étudier des références historiques et/ou d’actualité de programmes de même nature, à travers une analyse encadrée d’une dizaine de réalisations proposées par les enseignants ou à proposer par les étudiantes et les étudiants;
• s’initier, en pratique, aux principales réglementations applicables à ce type de programme et à ce type de site et, notamment, à la RT2020/RTRÉNOV (y compris bilan énergétique simplifié avec initiation à ARCHIWIZARD);
• s’initier, en pratique, à la notion d’économie de projet et d’équilibre budgétaire (estimation sommaire du coût des travaux avec évaluation du temps de retour);
• explorer, dans une démarche « écoresponsable », toutes les dimensions du projet sous l’angle du développement durable (initiation à la notion de certification);
• développer, dans le champ architectural, un travail, sur l’espace urbain, de prise en compte d’un site aux contraintes variées et d’intervention sur sa densité.