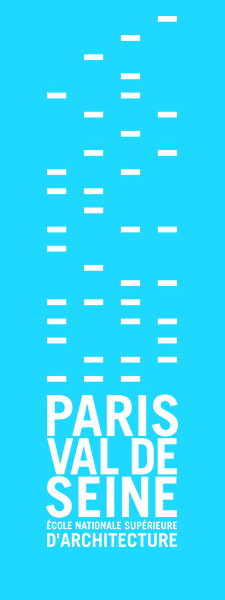« Au delà d’être une technique, le dessin est une manière d’appréhender le monde, de le sentir et de l’éprouver par l’observation. J’envisage le travail du dessin comme un approfondissement de l’attention que l’on porte aux choses, aux êtres vivants, à l’espace où l’on s’inscrit, mais aussi à l’usage que l’on fait des objets. »
En licence, certains étudiants arrivent sans jamais avoir dessiné. Le premier semestre vise donc à poser des bases à la fois théoriques et techniques, mais surtout à éveiller leur curiosité, à développer leur sensibilité visuelle au monde qui les entoure, et à initier une pensée critique vis-à-vis de ce qu’ils aiment ou rejettent, en explorant leur expressivité personnelle à travers le trait grâce à différents outils. Il s’agit d’apprendre à observer, à questionner ce qu’ils ont sous les yeux autant que ce qu’ils ressentent face à un espace ou une œuvre, non pas dans une logique de jugement, mais dans une démarche de compréhension sensible et d’analyse critique. Le dessin est avant tout une pratique permettant une reconquête de l’attention, attention tant mise à mal par l’accélération, comme pratique de la présence, capable de résister à l’accélération contemporaine, à l’hypervigilance et à la fragmentation de l’attention induite par nos environnements numériques.
À travers une diversité d’exercices et de médiums, les étudiant·es sont invités à explorer leur expressivité propre, à découvrir leur rapport au trait, à la forme, à l’espace. Cette approche inclut principalement des temps d’observation in situ lors de visites culturelles, des rencontres avec des œuvres, des lieux et des vivants — humains et non-humains. L’architecture, les objets, le végétal, l’animal, le minéral deviennent alors autant de sujets d’étude et de sources d’inspiration pour interroger notre rapport au monde.
Parallèlement à cette ouverture sur l’extérieur, un travail autour du corps, de la morphologie et du geste est proposé comme support pour expérimenter la composition, le volume, la performance ou encore l’édition, l'affiche. Le corps n’est pas seulement observé : il est éprouvé, ressenti, engagé dans le processus créatif, dans une approche transversale qui convoque également d’autres disciplines artistiques, comme la danse ou le théâtre.
Les évaluations prennent la forme de compositions synthétiques (éditions, installation, vidéos, inspiré par les carnets de voyage) et de projets plus personnels, permettant à chacun·e d’affirmer une posture singulière, en écho à des références artistiques, philosophiques ou écologiques. Il s’agit, in fine, de faire émerger une pensée plastique ancrée dans le sensible, capable de relier dessin et architecture, geste et intention, regard et éthique.