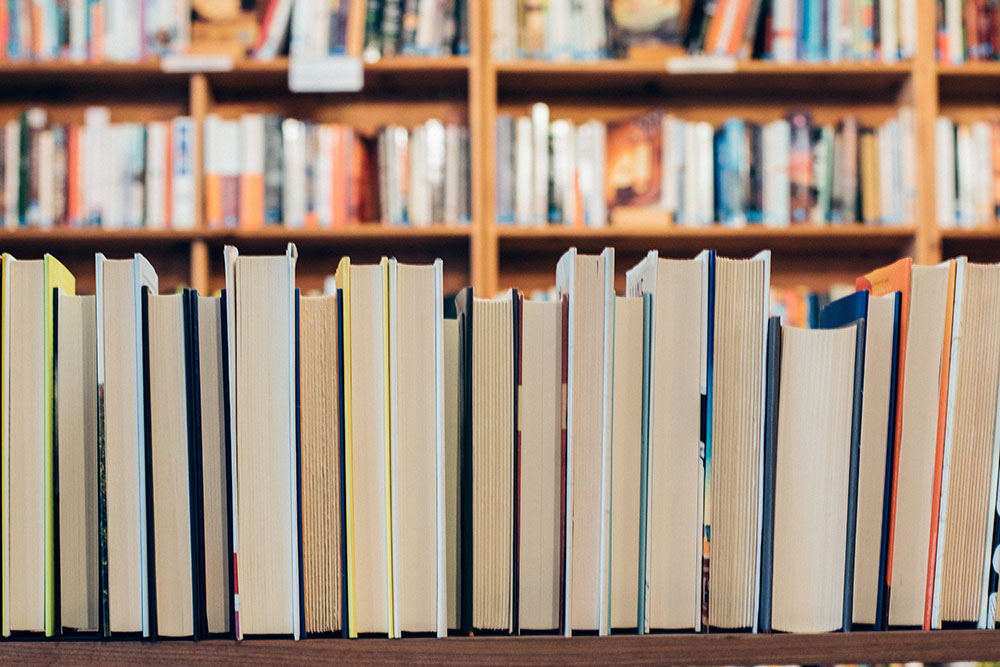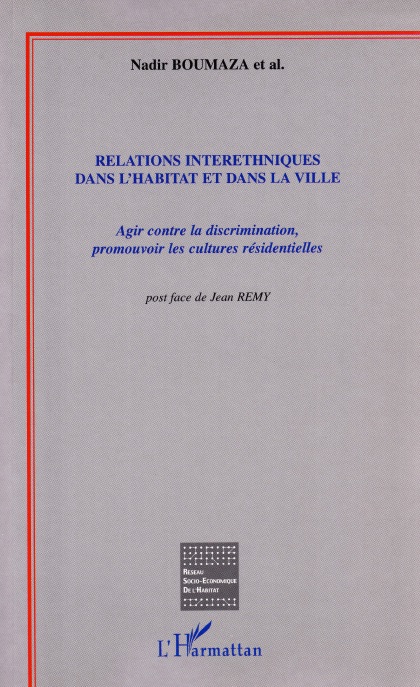
- Atelier
Publications du laboratoire CRH-LAVUE
Frey, Jean-Pierre
Relations interethniques dans l'habitat et dans la ville agir contre la discrimination, promouvoir les cultures résidentielles
Conception de l'habitat et expression culturelle
Date de parution : 2003
Date de parution : 2003
Éditeur : L'Harmattan
collection: Réseau Socio-économie de l'habitat
Pages : pp. 329-346 / 466
ISBN : 2-7475-4718-3
Domaines : Habitat
FREY (Jean-Pierre), « Conception de l'habitat et expression culturelle », in BOUMAZA (Nadir) sous la dir. de, Relations interethniques dans l'habitat et dans la ville agir contre la discrimination, promouvoir les cultures résidentielles, postface de Jean Rémy, Paris, Réseau Socio-économie de l'habitat/L'Harmattan, 2003, 466 p., pp. 329-346
Colloque du réseau socioéconomie de l'habitat : L'Habitat et la ville au regard des relations inter-ethniques, Grenoble, 26-27 mars 1998
Les travaux de recherche et les réflexions récentes menées sur les questions de ségrégation participent d'un réexamen des approches de la morphologie sociale et de la morphologie urbaine par la volonté de prendre en compte la diversité des populations considérées à partir de spécificités (origines, identités, place occupée dans la division du travail, etc.) culturelles ou ethniques. Le renouvellement des approches semble devoir beaucoup à la présence remarquée de populations dites "immigrées", comme si les phénomènes d'agrégation et de ségrégation au principe de l'alimentation des agglomérations par des populations de migrants était chose nouvelle dans les analyses de l'urbanisation. La spécificité des populations est cependant d'autant plus difficiles à saisir que, pour déjouer les pièges d'un racisme qui, par ailleurs, ne cesse de hanter les écrits d'urbanisme, les institutions détentrices de données et les chercheurs eux-mêmes s'interdisent prudemment de tenir compte de certains critères liés aux origines ethniques, à la religion ou à d'autres pratiques dites culturelles. Le mot "ethnie", et malgré les efforts positivistes des sciences humaines, est soit encore un simple euphémisme pour "race", soit désigne un groupe du même ordre mais à plus petite échelle. Attitude peut-être bien européenne, mais surtout française et, paraît-il, républicaine, effet du double traumatisme de la Seconde Guerre mondiale et des guerres de décolonisation, mais qui puise ses racines dans une histoire plus longue. Maurice Halbwachs témoigne assez bien de ces ambiguïtés par ses réticences à reprendre les concepts de la sociologie américaine dans les analyses que l'Ecole de Chicago fait de la morphologie urbaine tout en s'essayant aussi à une analyse plus risquée, mais sur l'exemple d'Istamboul, faute sans doute de pouvoir légitimement et pratiquement la mener sur une ville française étant donnée la nature des sources disponibles.
Nous entendons réfléchir plutôt aux unités spatiales auxquelles les analyses sociales se réfèrent, moins du reste pour repérer d'éventuelles ségrégations que pour simplement y lire des différences culturelles. Les travaux récents sur ces phénomènes, largement menés par des géographes, des sociologues, des démographes, raisonnent en général à partir de données quantifiées globales, mais pas uniquement puisque les enquêtes de terrain existent. Ces enquêtes offrent toujours la possibilité de collecter des données originales ou plus fines dans les lieux qui s'y prêtent le mieux. Elles s'appuient ainsi toujours sur un découpage de l'espace auquel il convient d'être particulièrement attentif. Ce b-a ba de l'herméneutique en matière de morphologie bute cependant sur une difficulté particulière, rarement problématisée : celle de la matérialisation des spécificités culturelles, que par commodité nous serions enclins à appeler le marquage des spécificités culturelles dans l'organisation des lieux. Ces phénomènes sociaux, culturels ou ethniques repérés dans l'espace, c'est-à-dire "localisés", renvoient généralement à des entités spatiales comme la localisation (distribution géographique), le quartier (urbain), l'immeuble voire le logement (lieux privilégiés de localisation des ménages dans les données des recensement), rarement au type d'édifice en fonction de sa conception architecturale.
Nous ferons l'hypothèse que ce n'est pas un hasard. Tout d'abord parce que le paysage proprement culturel que compose un parc immobilier est encore difficile à analyser autrement qu'en termes esthétiques ou patrimoniaux. Ensuite parce que la production architecturale n'a que rarement fait des édifices, dans la période contemporaine, le lieu privilégié de l'expression d'une spécificité explicitement culturelle, que ce soit celle du commanditaire, celle de l'architecte et encore moins celle du destinataire. Enfin parce que, à défaut que la spécificité des populations s'exprime clairement à travers un traitement proprement architectural, elle se matérialise où elle peut, comme une trace contrariée des pratiques d'appropriation dans un ensemble d'objets qui ne coïncide plus vraiment, si tant est que ce fut jamais le cas, avec les formes convenues du découpage de l'espace tel qu'on le produit et tel qu'on continue à le lire.
www.crh.archi.fr/spip.php