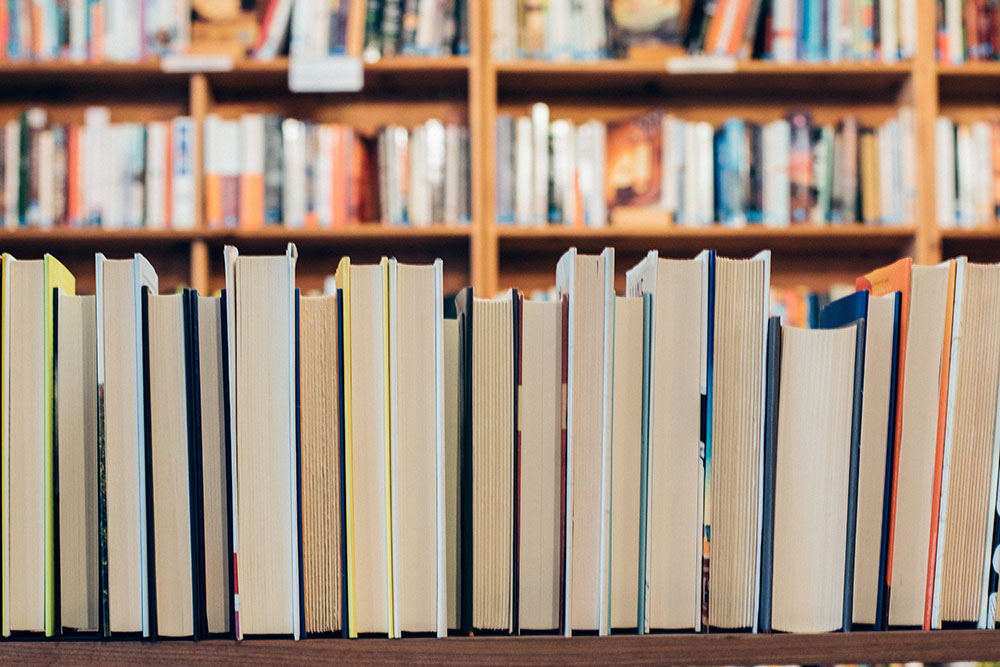- Atelier
Publications du laboratoire CRH-LAVUE
Frey, Jean-Pierre
LANGLOIS (Gilles-Antoine), Des villes pour la Louisiane française, théorie et pratique de l'urbanistique coloniale au 18e siècle
Préface
Date de parution : 2003
Date de parution : 2003
Éditeur : L'Harmattan
Collection : Villes et entreprises
Pages : 7-12 / 448 p.
ISBN : 2-7475-4726-4
Domaine : Urbanisme
Sur un terrain qui lui était familier —la Louisiane elle-même, mais aussi et surtout des bibliothèques, centres d'archives et personnes ressources sur la colonisation française de l'Amérique du Nord—, Gilles-Antoine Langlois entend entreprendre dans cette thèse la redécouverte symbolique d'un véritable territoire largement méconnu ou oublié. Dans l'optique d'une approche résolument interdisciplinaire à la croisée de chemins parfois tortueux —et n'étant que rarement synonyme de rencontres— provenant de la géographie, de l'urbanisme, de l'architecture et des génies civil et militaire, il s'agissait de se frayer un chemin permettant de se hausser à une largeur de vue dégageant le panorama d'une conquête territoriale se soldant par la construction d'un espace résolument nouveau. Villes nouvelles, certes, mais aussi espace social et fonctionnement institutionnel propres à une aventure dont on oublie trop souvent qu'elle suppose des audaces, des visées, des projets, des ambitions, mais aussi des improvisations, des bévues, des rectifications, des concessions et des renoncements. Bref, il s'agissait moins de dresser, comme se plaisent toujours à le faire les architectes et les urbanistes plus soucieux de convaincre de l'intérêt d'un ordonnancement nouveau dont le projet dessine les grandes voies que de rendre compte des affres de la fabrication des formes qu'adopte une société dans son ensemble, une image nouvelle de ces villes et de leurs territoires, que de contribuer, selon l'heureuse expression d'Henri Raymond, à une histoire architecturale et urbanistique de la société coloniale française en Louisiane.
Dans cette aventure spatiale de la raison conquérante des Lumières européennes sur le continent américain, que d'obscurs recoins réduits grâce à ce travail de nombreuses zones d'ombre s'effacent, des perspectives nouvelles se font jour, nous invitant ainsi à de nouvelles explorations. Peut-être est-ce l'idée de composition urbaine qui pourrait rendre le mieux compte des conditions d'édification de ce territoire louisianais. D'abord parce que c'est bien d'une urbanité nouvelle que sont porteurs à un titre ou à un autre et selon des degrés variables les conquérants, par rapport au territoire investi, à n'en pas douter, mais aussi par rapport à celle acquise en Europe et colportée en Amérique. Ensuite parce qu'elle ne cesse d'évoluer et de s'enrichir au contact des populations locales et de la société d'accueil, sans pour autant renoncer à laisser une empreinte spécifique. Il ne s'est en effet jamais agit de se fondre dans le paysage, mais au contraire d'y laisser des traces originales durables.
www.crh.archi.fr/spip.php