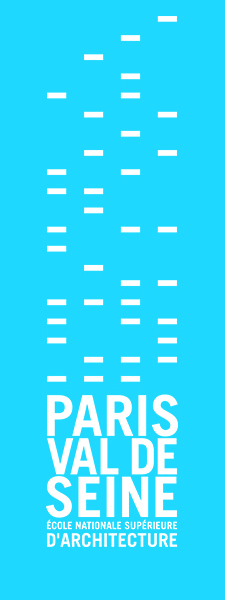FRUGALITE ET COMMUNE(S) FERTILE(S)
« Accompagner l’instauration d’une société heureuse et écoresponsable ».
Enseignants projet :
Sonia Cortesse, architecte
Paul-Emmanuel Loiret, architecte
André Avril, plasticien
Antoine Maufay, architecte ingénieur
Orientations principales
La pédagogie s’appuie sur les principes développés dans le manifeste de la frugalité heureuse et créative. Le mouvement constitué en 2018 et devenu international a vocation à transformer l’acte de construire les bâtiments et à ménager les territoires.
Extrait du manifeste
Le temps presse
L’alarme sonne de tous côtés. Les rapports du Giec confirment la responsabilité humaine dans le dérèglement global. Plus de 15 000 scientifiques l’affirment : il « sera bientôt trop tard pour dévier de notre trajectoire vouée à l’échec…..
…. La lourde part des bâtisseurs
Les professionnels du bâtiment et de l’aménagement du territoire ne peuvent se soustraire à leur responsabilité. Leurs domaines d’action émettent au moins 40 % des gaz à effet de serre pour les bâtiments, et bien plus avec les déplacements induits par les choix urbanistiques, telle la forte préférence pour la construction neuve plutôt que la réhabilitation. Choix qui suppriment, tous les 10 ans, l’équivalent de la surface d’un département en terres agricoles. L’engagement collectif et individuel s’impose….
La frugalité sera le vecteur des travaux de ce S7 à toutes les échelles et les étudiants vont :
-apprendre ensemble le territoire communal dans toutes ses connexions et particularités, sociologiques, historiques, géographiques, économiques, écologiques, ressources physiques et humaines, etc.
- établir un diagnostic holistique pour comprendre les enjeux (climat, eau, alimentation, énergie, etc.)
- se questionner : quels sont les besoins à court et long terme ? quels usages ? quelles sont les ressources disponibles à proximité ? faut-il encore construire ? faut-il démolir ? peut-on encore réduire les ressources consommées ? comment concilier réduction des besoins, qualité de vie et écoresponsabilité ? etc...
- écrire un récit et faire un projet nourri de beautés, de solidarités, de respect du vivant (tous), de proximité, de protection des sols, de l’aide à l’émergence de nouvelles filières, …
- privilégier la réhabilitation des bâtiments et des lieux avant d’engager des travaux neufs
- concevoir bioclimatique avec des techniques frugales, appropriées, low-tech, avec des matériaux bio et géosourcés, ou des matériaux de réemploi, issus de la déconstruction, en respectant le vivant et le déjà-là
Mots clés : frugal, coopératif, holistique, commun, fertile, nourricier, low-tech, vivant, déjà-là, faire mieux avec moins, bio et géosourcé, bioclimatique
Frugal, vient de frux, le fruit en latin. La frugalité est la juste « récolte des fruits de la terre » d’après le philosophe romain Apulée